10 février 2024
Le premier jour sans lui
En salle de permanence des avocats au Tribunal judiciaire de Paris, je dis d’une voix faible, « Robert Badinter est mort ». Une tête se lève, personne ne réagit vraiment, chacun replonge dans ses dossiers. Et puis la déception passée, l’émotion a fini par venir, submergeant petit à petit le déroulé de cette journée particulière d’audience de comparutions immédiates.
13h30 et l’audience va commencer à la 23ème chambre 2 des comparutions immédiates. Chose inhabituelle, l’une des trois juges qui assureront l’audience vient nous voir et discuter un peu avec nous d’un prévenu qui va passer, avec une aménité qui dépareille de l’éloignement dont se drapent les magistrats parisiens depuis qu’ils ont emménagé dans la tour d’ivoire du nord de Paris. Si ce n’étaient les bandes verticales satinées qui ornaient sa robe, on aurait presque dit une consœur prête à plaisanter avec nous des incongruités des dossiers du jour.
Je profite de cette proximité et je lui demande si le Tribunal compte dire quelque chose en ouverture d’audience. Elle me répond qu’elle va en parler à la Présidente et puis finalement, qu’elle s’en chargera elle même, ayant d’ailleurs rencontré Robert Badinter.
Comme souvent, beaucoup de jeunes gens sont présents en début d’audience. Les comparutions immédiates, c’est là bizarrement qu’on emmène les collégiens, pour leur montrer en guise d’édification, comment fonctionne la justice des derniers de la classe, du quotidien de la délinquance misérable.
L’assesseure, à la droite de la Présidente impassible, avant d’envisager le premier dossier de fond, prend la parole. Elle parle du vieux monde, pas si lointain, celui des bois de Justice, que Robert Badinter a mis à bas. Quelques mots, bien choisis, qui fondent sur la jeunesse qui lui fait face et qui désarment les avocats des deux côtés de la barre. Comme il est impossible d’applaudir, je pense à Monique Mabelly, la juge d’instruction qui a assisté à la dernière exécution capitale en France, et dont la lettre rendant compte de la mort d’Hamida Djandoubi a été donnée à Robert Badinter par son fils. Cette lettre, je l’ai lue plusieurs fois à haute voix à des membres de ma famille, à des proches, et je n’ai jamais pu la terminer sans que ma gorge ne se serre et que les larmes ne viennent.
J’ai l’honneur, de permanence côté partie civile, d’être le premier avocat à plaider. Je m’associe en tant que membre du barreau à l’hommage qui vient d’être rendu par le Tribunal, d’une seule phrase, sans trop en dire, pour ne pas gâcher le bel exorde de la magistrate, et je passe au dossier. Je me dis que si Robert Badinter a le temps de regarder derrière son épaule, pendant sa conversation avec Dieu duquel il espérait qu’il lui dise qu’il a fait de son mieux, il aimera cette scène simple des gens de Justice qui ont pris le temps de lui dire merci malgré la surcharge proverbiale du rôle.
Entre les suspensions d’audience, les langues se délient. J’ai la chance d’avoir pu échanger quelques mots avec Robert Badinter, lors de la cérémonie de prestation de mon « petit serment » avec 1750 autres élèves avocats en 2013, à laquelle nous fument tous adoubés par le maître. Alors que tous se dispersaient, des amis et moi l’attendions en haut des marches de la salle du palais des Congrès qu’il gravissait doucement, et miraculeusement seul. Je garde en mémoire ces quelques mots dérobés au milieu de la gigantesque nouvelle promo « Robert Badinter » de l’Ecole de Formation du Barreau, sa conviction que les Etats-Unis aussi finiraient par abolir la peine de mort, la persistance des combats à mener pour la dignité humaine en France et ailleurs, et cet ordre de mission : « Agissez ».
Robert Badinter était quelqu’un de fier de ce qu’il avait accompli, altier, et en même temps incroyablement accessible. Des centaines, des milliers d’avocats ont ce genre de souvenirs avec lui. Un autre confrère plus âgé me montre un selfie de lui à ses côtés. Il a ce sourire béat qu’ont les gosses qui posent pour une photo à côté de Zidane ou Platini.
Platini ou Zidane, il y a de ça chez Robert Badinter, pour nous les avocats, bien qu’il n’a jamais été un ténor pénaliste pur comme Hervé Temime ou Maurice Garçon, et que l’essentiel de sa renommée fut aspirée par 1981. Il est celui qui, a réussi là ou les Hugo, Jaurès ont échoué et il est devenu tellement plus qu’un avocat. Méthodiquement, avec préméditation, il a assassiné la peine de mort, cette barbarie dont la perversion était telle, qu’elle faisait naître en nous des sentiments de pitié pour des humains qui n’avaient rien fait pour la mériter, et il nous a libéré. A ce confrère condisciple de faculté, dont le talent est aussi haut que son cynisme, qui me disait que l’abolition de la peine de mort avait vidé de son enjeu la substance des assises, je répondais que moi je n’aurais pas pu devenir avocat et prêter mon concours à un système dont la pierre angulaire aurait été la peine de mort. Je n’aurais pas eu la force qu’a eu Robert Badinter de miner le système de l’intérieur.
Depuis longtemps, le grand âge arrivant, et l’abolition de la peine de mort ne s’étant pas étendue aux limites posées par notre condition humaine, je me disais qu’il était le dernier grand héraut de la République, qu’aucun Français encore vivant n’atteignait sa stature, et que la vigie sur la tour de garde serait laissée bien vide, même si comme son ami François Mitterrand auquel toute sa vie il fut loyal malgré tout, je crois aux forces de l’esprit, et qu’il ne nous quittera pas. A présent qu’il cède la place, que le timbre outré de ses mercuriales ne montrera plus l’évidence de la voie, j’attends, j’espère, je me persuade tout de même, que d’autres hommes se dresseront pour chasser les nuages et les tempêtes qui nous bouchent l’horizon.
La salle est désertée du public, l’audience des comparutions immédiates se termine avec le prononcé des derniers délibérés, presque tôt par rapport aux records que connaissent ces sessions à rallonge. La Présidente, soulagée, demande de manière rituelle à la représentante du ministère public si elle a de nouvelles réquisitions, ce à quoi à ce stade, il lui est toujours répondu par la négative. Et puis lentement, la compagnie se dissout, les prévenus, aux fortunes diverses, inconscients du départ du grand homme, commencent à humer le parfum d’une liberté sans doute provisoire, ou s’entendent réciter par le greffe le poème « A Fresnes Fleury la Santé » en fonction de la position de leur nom dans l’alphabet.
Il est 23H30, et bientôt nous aurons terminé, le premier jour sans lui.
A lire aussi sur Mediapart.
.
25 septembre 2023
Ariane Lavrilleux perquisitionnée et gardée à vue : Caveant Magistratus
Ariane Lavrilleux, journaliste indépendante ayant enquêté sur les errements des services de renseignement français en collaboration avec des sociétés privées et l’Egypte dans le cadre d’exécutions extra judiciaires, a été perquisitionnée et placée 39 heures en garde à vue par une juge d’instruction pour avoir travaillé et publié des informations classées confidentiel défense.
Pendant la République romaine, quand un péril imminent menaçait la nation, le Sénat nommait un ou plusieurs Consuls dictateurs temporaires pour prendre des décisions extraordinaires, rapides et jugées impérieusement utiles à la sauvegarde commune. Ce faisant, il accompagnait leur nomination d’une formule rituelle pour conjurer les éventuels abus de pouvoir : « Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat », souvent abrégé en « Caveant Consules« , et que l’on peut traduire ainsi : « que les Consuls prennent garde à ce qu’aucun dommage ne soit fait à la République« .
Aujourd’hui dans notre droit, il existe un article 413-10 du Code pénal qui punit « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée. ». Cet article et d’autres avec lui répriment la compromission du secret de la défense nationale .
Cette interdiction légale a vocation à s’appliquer à toute personne y compris journaliste qui se procure et/ou porte au public des informations classées secret ou confidentiel défense, sans que cette interdiction ne soit modérée par le fait que le sujet puisse être d’intérêt public. Elle et la procédure qui permet son application sont largement dérogatoires de notre droit commun comme pouvaient l’être les pouvoirs spéciaux des Consuls dictateurs romains.
Est-ce à dire qu’elle donne carte blanche à un magistrat qui l’invoque et entend l’appliquer dans toute sa rigueur?
En effet, cette loi entre en confrontation directe avec des normes qui lui sont supérieures, la liberté de la presse, dont le secret des sources est un des piliers, et qui est sous tendue par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour afférente. Ces principes, cardinaux dans notre Etat de droit, sont supérieurs à la loi qui ne peut les limiter de manière absolue comme le font l’article 413-10 du Code pénal et son application actuelle. Et ce, quand bien même ils s’appuient sur un rattachement bancal -opéré par la décision du Conseil constitutionnel QPC 2011-192- du secret de la défense nationale aux principes constitutionnels de « la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l’environnement, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire ». On peine à comprendre en quoi le secret autour du concours de la France dans des exécutions extra judiciaires de contrebandiers en Egypte participeraient à l’indépendance de la Nation et à l’intégrité du territoire. Au contraire ce genre de barbouzeries a plutôt tendance à donner des leviers à des potentats étrangers sur nos dirigeants politiques minant ainsi son indépendance.
Passant, le public a pu apprendre que l’utilisation la plus rigoureuse de cette loi consistant en la perquisition et la garde à vue d’une journaliste, a été mise en place par une juge d’instruction indépendante dont, d’après Ariane Lavrilleux, l’identité est protégée, car spécialisée dans l’anti terrorisme. Il est peut être plus probable qu’elle soit spécialisée dans le contrôle et le contentieux du secret défense, d’où son anonymisation, car ayant à en connaître, elle est une cible pour des puissances étrangères. On perçoit par là toute la problématique d’un magistrat anonymisé qui dispose d’un pouvoir sans contrôle (au moins pour le placement en garde à vue qui n’est pas contestable avant sa fin), qu’il peut utiliser contre des personnes aussi importantes dans une démocratie pleine et entière que le sont les journalistes en charge d’informer les citoyens.
Passerait presque encore, si ces mesures exceptionnelles à l’encontre d’une journaliste avaient été ordonnées par un procureur de la République. Considéré comme un magistrat en France, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme lui a dénié ce statut depuis longtemps en pointant sa soumission statutaire au pouvoir exécutif, ce qui est toujours le cas aujourd’hui, malgré l’interdiction toute théorique des consignes individuelles de la part du pouvoir politique.
L’indépendance d’un juge d’instruction, par ailleurs spécialisé dans les questions de secret défense, est elle à peine moins théorique. Les magistrats indépendants sont proposés à leur poste par la direction des services judiciaires, émanation de l’exécutif politique, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui n’a généralement aucun argument pour refuser cette nomination. Quand bien même, les magistrats sont en minorités au CSM, en partie contrôlé par le pouvoir politique.
On imagine ainsi la difficulté pour un juge d’instruction contrôlant les services de renseignement de refuser à ceux-ci trop d’actes d’enquête. Il serait d’une manière ou d’une autre, sinon évacué, facilement court-circuité. Les magistrats et cours spécialisés sont toujours bien moins protecteurs des droits des mis en cause, leur spécialisation étant un moyen pour l’Etat de contrôler et d’encadrer davantage leur nomination et leurs décisions.
Cela étant posé, ordonner la perquisition et la garde à vue d’une journaliste qui a mis en évidence les dérives du renseignement français en Egypte (et donc prouvé que certains documents classés confidentiel ou secret défense le demeuraient manifestement de manière abusive), constituent tout de même des actes dont on aurait pu attendre d’un juge d’instruction qu’il n’en prenne ni l’initiative, ni ne les autorise.
D’abord parce que surement grâce à une enquête ayant bénéficié de tous les moyens de la DGSI, et qui est probablement parvenue à identifier au moins une source d’Ariane Lavrilleux (ce qui pose déjà en soi un problème du point de vue de la liberté de la presse), sa perquisition et surtout sa garde à vue ne s’imposaient pas, des mesures alternatives auraient pu être utilisées, et l’on peut donc s’interroger légitimement sur les raisons réelles de ces actes revêtant un caractère exceptionnel vu la cible.
Ensuite parce que cet acte, extraordinaire dans une démocratie libérale comme la France, cause un préjudice réputationnel à notre nation mais aussi sape la confiance que peuvent avoir les Français dans nos institutions censées protéger autant que possible la liberté de l’information, et ne pouvant en opérer la limitation que lorsque l’intérêt général et la sécurité de l’Etat qui en sont la cause sont dûment caractérisés au delà du seul classement confidentiel ou secret défense, ce dont nonobstant le secret de l’instruction et donc la connaissance parcellaire du dossier, on peine à croire en l’espèce.
Prenant acte de la justesse du travail d’Ariane Lavrilleux, et de son témoignage à l’issue de sa privation de liberté, il est difficile de ne pas faire le constat grave qu’un magistrat indépendant qui, froidement, fait une application maximaliste de la loi en l’articulant de manière manifestement insuffisante aux principes qui lui sont supérieurs, et appose sa signature en bas d’une ordonnance de perquisition et de garde à vue d’un journaliste dans l’exercice loyal de sa fonction, verrouille alors un jalon funeste dans notre histoire politique, et ce faisant, cause un dommage irréparable à la République.
A lire aussi sur Mediapart
3 mars 2023
Le registre, symbole de la démission des juges pour le droit des exilés en rétention
Alors que la Cimade s’est retirée en février du centre de rétention du Mesnil-Amelot déplorant la violation des droits élémentaires des retenus, les juges de la liberté et de la détention semblent avoir abandonné l’idée d’être les gardiens effectifs des droits des exilés. Un symbole de ce désintérêt : le registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Au cours de leur rétention qui peut durer jusqu’à 90 jours, les retenus administratifs voient leur mesure de rétention automatiquement contrôlée par le juge de la liberté et de la détention (JLD) quatre fois lors des demandes de prolongation de la mesure par les préfectures, qui dans leurs requêtes, doivent fournir toutes les pièces utiles au contrôle de la rétention par le juge à peine d’irrecevabilité et donc de remise en liberté du retenu si la requête est hors délai (article R 743-2 du CESEDA).
L’une de ces pièces utiles est le registre prévu par la loi, à l’article L 744-2 du CESEDA :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention […] .»
Ce registre doit être fourni à l’appui de la requête en prolongation de la rétention du Préfet, et il devrait normalement contenir des informations sur les conditions du placement ou du maintien en rétention, c’est à dire un rapport individualisé sur l’exercice effectif ou non des droits ouverts à tous les retenus, comme l’accès à un médecin, un avocat, les visites reçues par des amis ou des membres de la famille.
Voilà à quoi ressemblait un registre il y a encore un peu plus d’un an :
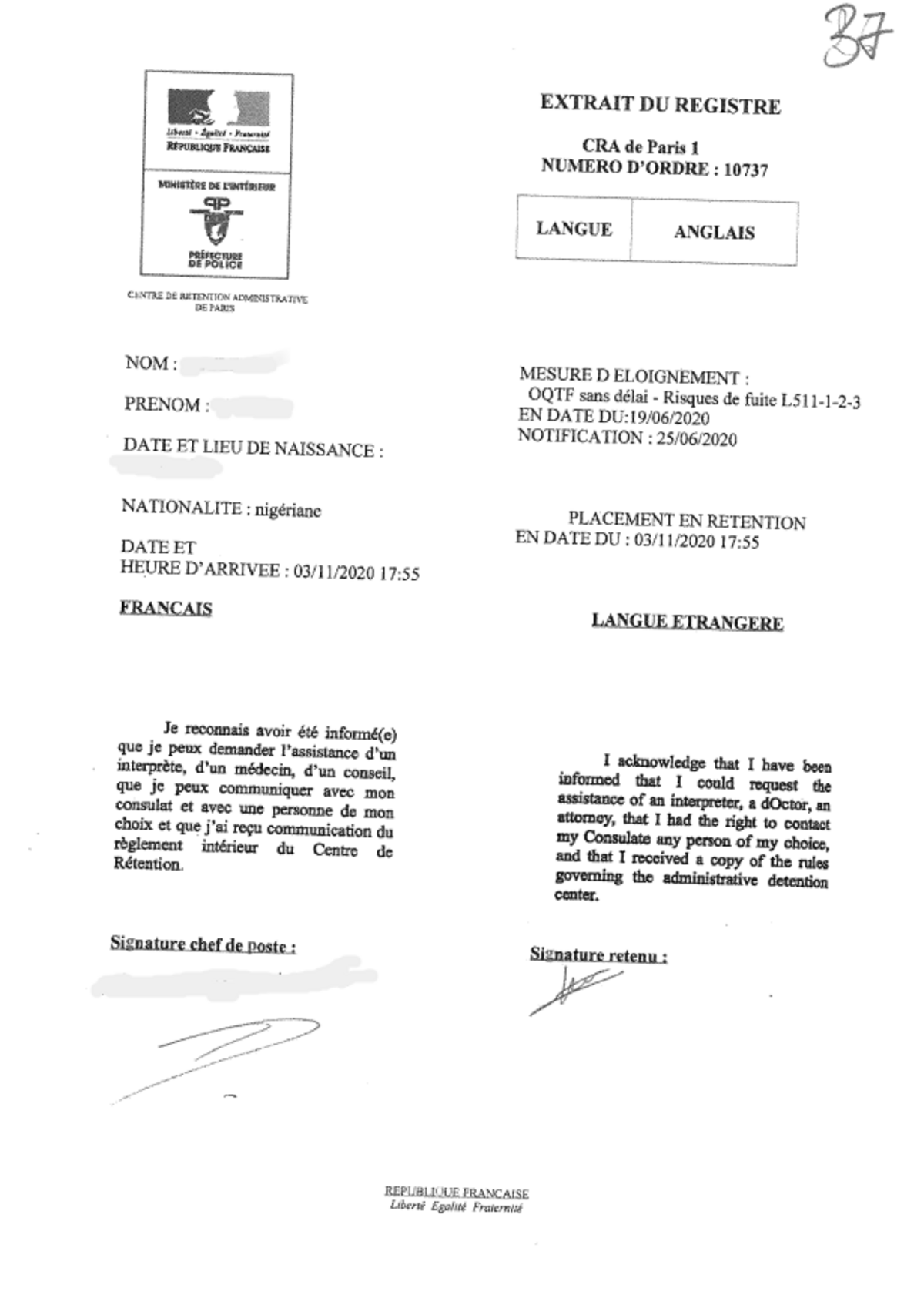
La simple signature du retenu à l’entrée au CRA, en dessous d’un texte standard sur ses droits, traduit dans une langue qu’il comprend, suffisait aux juges pour contrôler les conditions du placement ou du maintien en rétention du retenu. Ce registre valait pour les 90 jours que pouvait durer la mesure.
Devant l’insistance des avocats et des remises en liberté sur ce chef, il a été jugé que ce registre devait être « actualisé' » pour chaque requête du préfet en prolongation de retenus administratifs. Un registre ressemble désormais à ça :
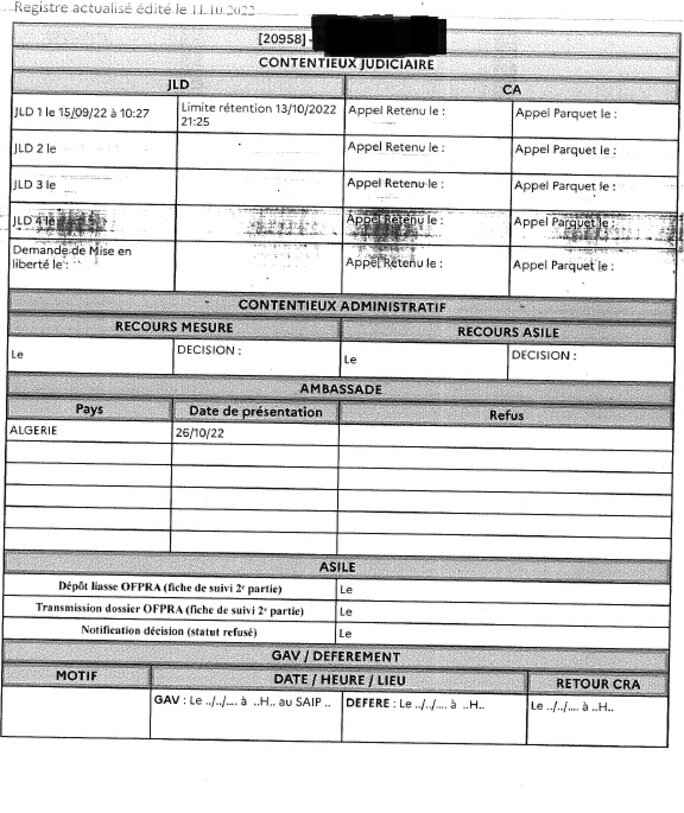
Ce registre actualisé ne comporte donc que des mentions procédurales sur les dates limites avant prolongation et les décisions des JLD et des appels, sur les éventuels recours administratif ou demande d’asile, sur les gardes à vues qui peuvent avoir lieu à la suite de refus d’embarquer.
Aucune mention sur les conditions du maintien en rétention comme l’exige pourtant la loi, aucune précision par exemple sur le fait que le retenu a vu ou non un médecin, a pu recevoir des membres de sa famille ou des amis. Ce laconisme aboutit à ce que toutes les plaintes des retenus devant le juge concernant les violations de leur droit ne reposent que sur des éléments déclaratifs et qu’ils ne permettent donc pas au juge de les retenir pour prononcer une remise en liberté.
La rétention est une mesure privative de liberté, et ceux qui en font l’objet ne doivent pas avoir moins de droit que par exemple, les gardés à vue. A la fin d’une garde à vue, il est dressé un procès-verbal qui récapitule l’exercice effectif des droits du gardé à vue, à quelle heure et pendant combien de temps il a vu le médecin, son avocat, sa possibilité d’appeler et/ou de faire prévenir un proche, jusqu’aux heures auxquelles il a été nourri.
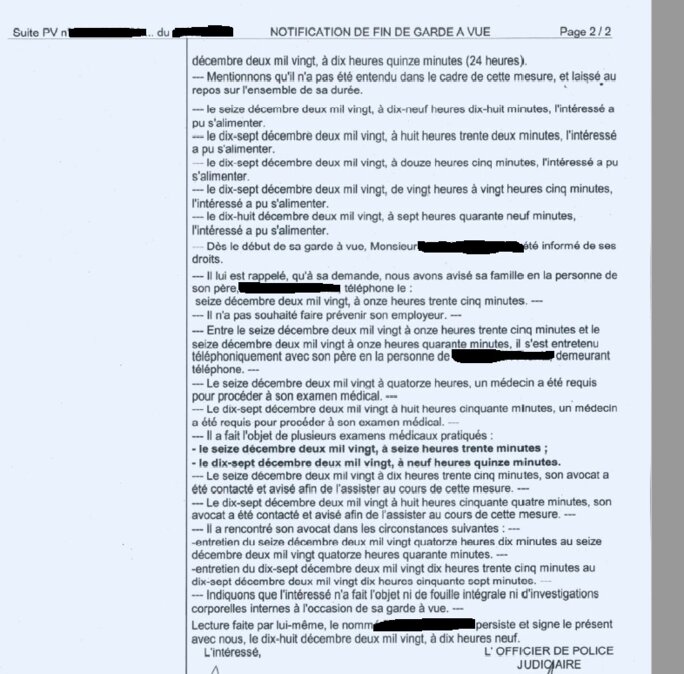
Ce procès-verbal fait foi et si le gardé à vue se plaint qu’il n’a pas pu voir son avocat et que ce PV ne mentionne rien, alors la garde à vue est annulée. En matière de rétention administrative, rien de tout cela , nous sommes censés croire que tout se passe bien au CRA et que le juge n’a pas à contrôler l’exercice effectif des droits, synonyme pourtant incontestable des « conditions du maintien en rétention » du texte légal.
Donnons alors la parole à un JLD parisien, pris au hasard parmi les milliers d’ordonnances de prolongation qui sont décidées chaque année par cette juridiction. Voilà comment à mon sens, les JLD refusent d’assumer leur rôle de gardiens des libertés, en interprétant très librement le mot « conditions » et en ajoutant à la loi des précisions « sur la situation administrative et judiciaire de l’intéressé » qui n’existent pas dans le texte :
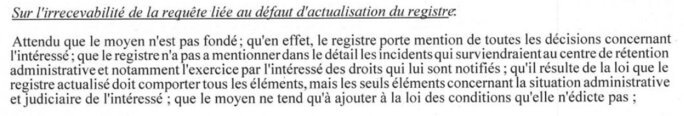
Si le registre ne devait comporter que les seuls éléments concernant la situation administrative et judiciaire de l’intéressé, pourquoi alors faire figurer dans le registre initial de placement la mention selon laquelle le retenu a bien été informé de ses droits au centre de rétention, dont la possibilité de voir médecin et avocat?
Il est pour toute personne particulièrement désagréable de s’entendre dire qu’elle a formellement des droits, et de constater dans la réalité qu’ils n’existent pas et surtout, qu’aucune autorité ne veille à leur bonne application, ou ne sanctionne réellement leur violation. Spécialement pour une personne exilée à qui il ne reste bien souvent que ses droits inaliénables. L’on objectera peut être que forcer les policiers des CRA à tenir un registre précis des conditions individuelles de rétention prendrait trop de temps, coûterait trop d’argent, dans un contexte budgétaire contraint . Oui chacun le sait; l’Etat de droit coûte plus cher que l’Etat sans droit. Mais chacun de nous l’a appris et le croit, il rapporte tellement plus.
A lire aussi sur Mediapart.
.
5 mars 2022
Silence, on signalise
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sécurité intérieure et responsabilité pénale, possibilité est donnée aux forces de l’ordre de recourir à la prise d’empreintes digitales forcée sur les gardés à vue qui la refusent, y compris les mineurs. J’ai assisté hier pour la première fois à la mise en œuvre de ce qui constitue un nouveau recul français sur le plan des traitements inhumains et dégradants.
La personne que j’assiste est une jeune bosniaque rom mineure qui se livre à des vols habituels à Paris, appelons là S. Elle a été arrêtée avec une de ses amies après une tentative de vol sur un couple asiatique. Ces faits, elle ne les nie pas. En revanche, comme toutes les jeunes filles roms qui se livrent à cette délinquance habituelle, S. est déterminée à respecter la consigne qui lui a été donnée de ne surtout pas laisser prendre ses empreintes digitales afin de ne pas pouvoir être identifiée et de faciliter son utilisation le plus longtemps possible par le réseau sur le territoire, avant qu’elle ne regagne son pays d’origine, une fois que sa majorité sera devenue trop évidente.
Ces dossiers là sont traités rapidement par la police et la justice. L’on ne cherche même plus à caractériser une éventuelle traite des êtres humains, les roms mineures sont en général, du moment qu’elles ne commettent pas de violence, soit relâchées à l’issue de la garde à vue, soit placées en foyer duquel elles partent immédiatement pour regagner leur campement et leurs occupations. Leur délinquance est d’une trop basse intensité pour les mettre en prison, l’indifférence et les préjugés avec lesquels leur peuple est perçu, et l’organisation extrêmement bien huilée des réseaux criminels roms font que les pouvoirs publics ont abandonné toute velléité de tenter de les extraire de leur milieu et de leur apporter protection et éducation.
Mais depuis la loi sécurité intérieure et responsabilité pénale, les policiers, par la grâce de l‘article 55-1 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ont maintenant le droit de procéder à ce qu’on appelle dans le jargon, une « signalisation » sans consentement, du moment qu’il y a un refus caractérisé et que l’infraction qui a justifié la garde à vue est punissable de trois ans d’emprisonnement maximum pour les adultes, et cinq ans pour les mineurs, sachant que le vol en réunion est puni d’une telle peine. Il suffit donc à deux mineurs de voler ou de tenter de voler à au moins deux pour être éligibles à ce nouveau traitement. La députée ultra conservatrice Emmanuelle Menard ne craignait pourtant pas de demander un abaissement de ce seuil lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale car « quand on est puni pour un crime ou un délit sanctionné de cinq ans d’emprisonnement, ce n’est pas rien ; ce n’est pas une petite infraction qui a été commise ».
« Il ne s’agit pas de faire du mal aux gamins » a dit le Garde des Sceaux dans ces mêmes débats parlementaires, avant d’ajouter : « au tamis du pragmatisme, du réalisme et de l’efficacité, cette mesure est indispensable« .
L’objectif pragmatique réaliste et efficace ici est de mettre une identité précise sur chaque délinquant, notamment mineur, prendre date, écarter le plus de mineurs douteux, et dans le cas des roms, tracasser les réseaux qui ne pourront plus utiliser les jeunes mineurs aussi facilement.
Mais quiconque, cet objectif en tête, a pensé cette nouvelle disposition légale, forcément n’a jamais travaillé dans un commissariat de police et assisté à l’ambiance souvent extrêmement tendue qui règne entre des personnes privées de liberté et celles qui les gardent, quand ceux-ci doivent forcer ceux là à faire quelque chose. Je ne souhaite à personne d’assister au spectacle de policiers qui veulent soumettre un gardé à vue devenu récalcitrant pour quelque raison que ce soit, et qui est plein d’adrénaline. Ces moments là sont dangereux, pour les gardés à vue, et même quelques fois pour les policiers. Le plus souvent ils sont hors de notre vue, mais, pendant une audition, ou au moment d’aller en cellule, nous y assistons de temps à autres, et nous ne pouvons qu’imaginer à quel point ces moments de violence, parfois légitimes, parfois non, sont encore plus durs quand nous ne sommes pas présents, à l’abri des murs des commissariats, de la hiérarchie et de l’esprit de corps qui y règne.
Cette nouvelle disposition inique, je l’avais pressenti dès que j’en avais pris connaissance, est juste l’assurance que ces incidents vont se multiplier, provoqués par la détermination des policiers à obéir aux ordres qui leurs sont donnés et aux textes légaux, et à celle de certains gardés à vue à ne pas donner leurs empreintes digitales. On saisira des bras, des jambes, on desserrera des doigts de force et on les maintiendra tendus pour les apposer sur l’encre.
Je pense à cela quand j’apprends que la jeune personne que j’assiste va avoir droit à ce traitement. Hier, elle a fait part au médecin de son absence de règles depuis quatre mois, et elle nous a montré son ventre arrondi. A l’hôpital, on s’est contenté d’un test négatif, on a dit qu’on allait faire prise de sang et échographie pour être sûr, mais on a finalement rien fait. Et voilà une mineure, avec une grossesse à risque, qu’on va donc forcer à donner ses empreintes par la grâce de la violence légitime.
Ce sera la première fois pour les policiers aussi. L’audition pendant laquelle elle a refusé de donner ses empreintes est terminée et l’un des policiers est arrivé vite, pour dire que le procureur avait donné l’autorisation. Le texte légal dispose que je sois prévenu. Je le suis de facto. Il prévoit aussi que les tuteurs légaux, à défaut l’« adulte approprié » soient prévenus. J’ai bien tenté d’observer qu’il faudrait prévenir la protection judiciaire de la jeunesse, mais on s’en passera.
S. parle bien le français, elle a compris que c’était le moment, le policier la saisit par le bras, elle s’effondre par terre, pleure, crie qu’elle ne veut pas, le policier tente de la relever, sans y parvenir, d’autres arrivent déjà. Je demande a assister à la prise d’empreinte, la loi ne le prévoit pas et l’on me fait sortir. Je ne peux pas insister, je sais à quel point notre présence est tolérée dans les commissariats et que toute tentative de sortir de notre rôle strictement borné peut donner lieu à des débordements. Un commissariat n’est pas un lieu où l’on déclame sérieusement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Je suis rentré au cabinet en me disant comme d’habitude que j’avais fait ce que je pouvais et ce que je devais. J’ai élevé des protestations formelles et j’ai vu, encore une fois, la facilité avec laquelle un texte de loi peut nous amener à repousser petit a petit les limites de la dignité humaine, et j’en veux aux législateurs qui concevant et votant ces textes ne pensent pas qu’ils salissent ceux qui vont devoir les appliquer et les subir. Je me suis aussi rappelé d’un Confrère qui nous avait dit ne pas nous contenter de notre rôle d’auxiliaire de Justice, car l’auxiliaire disait-il, c’est littéralement ce qui se définit par quelque chose d’utile, mais de pas indispensable. J’ai l’impression de n’avoir été ni indispensable, ni utile.
Il est 17h40, les 24 heures de garde à vue se terminent, j’appelle pour avoir des nouvelles. S. a résisté, et les empreintes n’ont pas été prises, à peine une photo. Le policier au téléphone me dit simplement: « on ne vas pas lui casser les doigts ».
A lire aussi sur Mediapart.
.
.
9 juillet 2020
Une QPC sur l’accès obligatoire à l’avocat en garde à vue pour les majeurs
.
23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris, comparutions immédiates, minuit, l’heure du crime? Non, l’heure de déposer une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la rupture d’égalité entre mineurs et majeurs dans l’accès à l’avocat en garde à vue.
Quelques heures avant que je ne plaide, la représentante du ministère public était venue me demander in petto, sourire un brin narquois, de retirer ma QPC, vu le rôle surchargé du jour et vu que « l’incompétence négative du législateur ça n’existe pas ».
Cette Question Prioritaire de Constitutionnalité, je la prépare depuis quelques temps et je me suis dit qu’il n’y avait pas meilleure chambre que celle des comparutions immédiates pour la poser, avec ses damnés de la terre déversés dans le box des prévenus à la sortie de la garde à vue, et qui n’ont pour la plupart, pas vu d’avocats avant d’arriver au Tribunal.
Cette QPC, elle part du constat que je fais en tant que permanencier du bureau pénal du barreau de Paris en garde à vue : Malgré le choix qui leur est laissé depuis 1993 pour un entretien et depuis 2011 pour les auditions et confrontations, un grand nombre de gardés à vue majeurs choisissent de ne pas avoir recours à l’avocat pendant cette mesure. Pourquoi choisir de se passer de nous, alors que tant de mes prédécesseurs se sont battus pour que notre présence en garde à vue soit autorisée et rendue gratuite, pour une meilleure garantie des droits de la défense dès le stade de la garde à vue?
Certains gardés à vue expliquent que malgré leur refus d’assistance d’un avocat, consigné sur le procès-verbal de notification des droits, ils ont bien dit qu’ils en voulaient un. Mais ces situations de déloyauté flagrante de l’officier de police judiciaire sont rares, encore qu’elles aient en partie motivé la mise en place de l’expérimentation prévue par la loi Belloubet de l’enregistrement sonore de la notification des droits au gardé à vue par l’OPJ. En réalité c’est bien souvent le gardé à vue qui choisit délibérément de se passer de l’assistance gratuite d’un avocat désigné par le Barreau, parce qu’il pense que la procédure risque de durer plus longtemps, ou qu’il aura l’air coupable auprès des juges s’il demande un avocat, ou que son affaire n’est pas assez importante pour faire intervenir un avocat.
Rien n’est plus faux que ces idées préconçues, mais elles sont largement répandues dans la population et elles influent d’autant plus le gardé à vue qu’il se trouve dans une situation de privation liberté qui le rend de facto vulnérable et qui vicie son consentement à la base de son choix de ne pas bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il faut aussi le dire, si les policiers et gendarmes font rarement pression directement pour que les gardés à vue ne prennent pas d’avocat, ils ne font rien pour les détourner des fausses idées indiquées au paragraphe précédent, et cela suffit à orienter les gardés à vue dans la direction qu’ils souhaitent. Même si la venue des avocats dans les commissariats se passe plutôt mieux qu’on ne pouvait l’espérer depuis 2011 et notre irruption dans les auditions aux côtés de nos clients, les forces de l’ordre n’ont pas intérêt à ce que nous soyons saisis, parce que cela rajoute un travail administratif et logistique pour eux, et parce que nécessairement, un rapport de force supplémentaire s’installe contre eux.
Alors que faire? Depuis 2016 et la transposition d’une directive européenne, l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante a été modifiée et rend l’assistance de l’avocat non plus facultative mais obligatoire pour le gardé à vue mineur, parce que l’on estime que les enfants sont particulièrement vulnérables.
Mon postulat est de dire que la majorité ne rend pas moins vulnérable un gardé à vue, qui, privé de sa liberté, souvent dans des conditions déplorables, pour un temps long, forcé d’obéir à des personnes qu’il ne connait pas, parfois atteint de handicaps sociaux et/ou psychiques, se trouve précisément dans un statut qui se rapproche de celui de l’enfant.
Inversement, le mineur est plus vulnérable qu’un adulte face à un escroc ou un voleur, mais face à des policiers ou gendarmes qui ne sont pas censés lui être hostiles ou tout du moins, qui ne sont pas censés lui vouloir du mal, il n’est pas plus vulnérable qu’un adulte.
Ainsi, la situation d’un mineur n’étant pas différente de celle d’un majeur en garde à vue du point de vue de la vulnérabilité -critère qui a motivé la directive européenne et la réforme de l’ordonnance de 1945 rendant la présence de l’avocat obligatoire et pas seulement facultative pour le mineur gardé à vu -, le traitement n’a pas à être différent.
Ma QPC pose donc la question de la constitutionnalité de ce traitement (prévus aux articles 63-3-1 alinéa 1, 63-4 alinéa 3, 63-4-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale) confronté aux articles 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (principe d’égalité), et 16 de cette même Déclaration (droits de la défense). Par incompétence négative, c’est à dire par abstention de réforme de ces articles concernant les majeurs après la réforme sur les mineurs, le législateur viole-t-il la Constitution?
Évidemment, dans cette heure tardive et moite, les magistrats, s’ils m’ont écouté sans bailler, s’ils se sont retirés pour délibérer comme la loi les y oblige, ont péremptoirement décidé que le critère de sérieux de la question n’était pas rempli pour transmettre la question à la Cour de cassation, car « le législateur a choisi de différencier le traitement réservé aux mineurs du fait de leur vulnérabilité ». Tout mon argumentaire sur l’équivalence de vulnérabilité entre mineurs et majeurs a été balayé sans autre explication.
Néanmoins ce débat doit continuer d’exister : La question n’a pas été tranchée par le Conseil constitutionnel et les circonstances ont de toute façon changé depuis la déclaration de constitutionnalité d’un des articles précités du Code de procédure pénale. Elle est applicable à tous les litiges dans lesquels le prévenu majeur a choisi de ne pas bénéficier de l’assistance d’un avocat en garde à vue. Le Tribunal a donc reconnu que deux critères sur trois étaient remplis.
Je réécrirai cette QPC, l’étofferai, j’attendrai de meilleures réponses, plus précises des magistrats. Je continuerai de penser, d’écrire et de plaider que si après tant de combats devant nos juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’Homme, l’avocat a pu mettre le pied dans la porte de la garde à vue, le problème ne fut que déplacé en amont du choix que doit faire le justiciable de faire appel à un avocat ou non, choix nécessairement vicié par sa privation de liberté déjà effective et la vulnérabilité qui en découle.
Ce combat, avec notre présence en perquisition, et celui de l’accès au dossier, doit être mené : A tout le moins, tout gardé à vue devrait s’entretenir de façon obligatoire avec un avocat quand il est privé de sa liberté, quoi qu’il décide ensuite.
A lire aussi sur Mediapart.
.
23 mars 2020
Services réservés aux femmes, une discrimination légitime?
.
Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, femme noire, choisit d’enfreindre volontairement le règlement des transports publics de la ville américaine de Montgomery, en refusant d’obéir à l’injonction du conducteur de bus James Blake d’aller s’asseoir au fond et de laisser sa place assise à une personne blanche.
Ce moment de l’histoire américaine est ce que les anglo-saxons appellent une milestone dans la lutte pour l’abolition de la ségrégation et des discriminations dans le monde occidental.
Le 28 février dernier, un article du Monde signé Pascale Krémer faisait état du développement croissant de services uniquement réservés aux femmes, comme des voyages, des soirées, des salles de sport, et donc, jeu de miroir le plus marquant avec le moment Rosa Parks, des compagnies de taxi ou VTC réservées aux femmes avec des conductrices uniquement femmes. Ces services répondent à une demande forte après le mouvement #Metoo, pour pallier les problèmes de harcèlement sexuel que subissent les femmes au quotidien.
Si aux Etats-Unis, la non mixité est un moyen répandu et accepté dans le militantisme des groupes sociaux subissant des discriminations, chacun a pu constater à quel point elle était très mal perçue en France par un large spectre politique, concernant par exemple les « camps d’été décoloniaux » ou des marches non mixtes. Une pratique qui pose problème dans le milieu militant, où elle pourrait pourtant se justifier pour des raisons recevables du point de vue de la recherche universitaire ou de la libération de la parole des discriminés, pose d’autant plus de problème quand elle naît dans l’accès aux services où l’on aura davantage tendance à s’émouvoir d’une solution dont on estimerait qu’elle renvoie à une politique d’apartheid inversé, et dans un pays ou les pratiques dîtes de discriminations positives sont mal tolérées.
Du point de vue du droit, immédiatement, le juriste tique et voit les problèmes que ce genre de solution pose vis-à-vis de notre système universaliste réprimant au moins formellement la plupart des discriminations, à fortiori dans l’accès à un emploi et l’accès à un bien ou service.
Rappelons donc au besoin qu’au titre de l’article L 121-11 du Code de la consommation , « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ».
Ensemble l’article 225-1 du Code pénal qui dresse un inventaire de ce que constitue une discrimination et qui y inclue bien évidemment la distinction fondée sur le sexe, l’on comprend qu’il est à première vue difficilement envisageable de réserver la vente d’un service à une femme, à l’exclusion des hommes.
Concernant l’embauche, l’article L1131-1 du Code du travail proscrit le fait d’écarter une candidature en se basant sur le sexe de la personne. Néanmoins des exceptions sont prévues par le Code du travail quand le sexe est déterminant pour le poste (par exemple, recherche d’un rôle d’acteur féminin) où pour des questions de discrimination positive entrant dans un plan politique prévu pour atteindre l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Du point de vue du consommateur, nous le voyons, la marge est réduite. Il est à ce jour très difficile de justifier la restriction d’accès à un service de taxis pour ne le réserver qu’aux seules femmes.
Du point de vue de l’embauche, le sexe de la personne ne saurait être déterminant pour conduire un véhicule, et même s’il est vrai que les femmes sont très minoritaires chez les taxis et VTC, l’on voit bien qu’il s’agit moins pour la start up qui pratique cette discrimination d’œuvrer pour l’égalité femmes-hommes dans ce secteur, que de proposer un service dans lequel des femmes ne seraient pas susceptibles d’être importunées par des hommes. De toute manière, une telle action devrait être supervisée par les pouvoirs publics pour être licite du point de vue de l’objectif de promotion de l’égalité femmes-hommes.
Voici donc les termes du problème. D’un côté, nous avons un principe général fort qui proscrit les discriminations dans la vente de biens et services et dans l’embauche, avec le but avoué quand il a été instauré, de lutter contre les discriminations que subissaient les minorités et les groupes sociaux dominés. De l’autre, des membres d’un groupe social, les femmes, dont toutes les études montrent qu’il subit des discriminations majeures dans tous les secteurs de la société et du harcèlement au quotidien, souhaite justement bénéficier d’une discrimination les favorisant pour remédier à ce problème, au moins de façon limitée et temporaire.
Dans son ouvrage dont le titre est connu au-delà même de la sphère juridique « Le Gouvernement des juges », Edouard Lambert nous dit que le juriste, par nature, est un être fondamentalement conservateur. C’est parce que sa matière, la loi, est une norme qui proclame des axiomes formés à partir de situations et de faits économiques et sociaux qui sont déjà périmés au moment de la promulgation, qu’il ne peut en être autrement. Ainsi, le juriste aura toujours tendance à utiliser les grands principes malléables des Constitutions pour barrer la route aux idées progressistes qui souhaitent répondre à un problème social qui ne s’était pas posé au moment de l’écriture des Constitutions et des lois en vigueur.
Edouard Lambert avait montré au début du siècle dernier comment la Cour suprême des Etats-Unis s’était servie des principes forts de la Constitution et de ses amendements pour invalider les lois des Etats américains qui souhaitaient donner aux ouvriers une protection sociale, ou qui interdisaient aux patrons américains de refuser l’embauche d’ouvriers syndiqués au nom de la liberté contractuelle.
Plus dérangeant encore pour le sujet qui nous concerne, au nom du principe d’égalité porté par le quatorzième amendement de la Constitution américaine, bien des cours américaines avant la première guerre mondiale justifiaient assez cyniquement la ségrégation entre noirs et blancs dans l’accès à la propriété ou dans les transports au motif que si les noirs ne pouvaient avoir accès à certains espaces réservés aux blancs, d’inégalité il n’y avait point, car les blancs eux-mêmes ne pouvaient avoir accès aux espaces réservés aux noirs, faisait ainsi fi de l’inégalité structurelle qui existait dans les espaces alloués aux deux groupes sociaux.
La seule chose qui force en général les juges à aller de l’avant, ce sont les troubles sociaux et les révoltes populaires engendrées par leurs décisions qui parfois même les menacent directement, comme quand devant le refus obstiné des Cours américaines de valider des statuts d’Etats fédérés protecteurs pour les ouvriers, ceux-ci organisèrent un mouvement très fort pour instaurer un principe de destitution populaire des juges (recall).
Aujourd’hui, si un homme mécontent d’avoir été éconduit par une compagnie de VTC réservée aux femmes portait plainte, il y a fort à parier qu’il obtiendrait gain de cause au titre des dispositions précitées, et que la compagnie serait forcée de revoir ses pratiques.
Pourtant nous voyons bien qu’il y a quelque chose de dérangeant dans cette approche. Tout comme il fallait doter à la fin du XIXème siècle les ouvriers d’une protection sociale, nous savons aujourd’hui que la situation des femmes n’est pas satisfaisante vis-à-vis du harcèlement et que certains expédients doivent être trouvés en attendant que la situation évolue lentement.
Si Rosa Parks s’était révoltée dans les années 50 contre une discrimination, c’est qu’elle en pâtissait. Aujourd’hui des femmes pâtissent de l’égalité formelle qui mélange hommes et femmes dans les transports et dans toutes sortes de services. Et depuis très longtemps nous tolérons une entorse à l’égalité en réservant des toilettes aux femmes et aux hommes pour des raisons au départ sexistes (c’est même une obligation pour l’employeur dans le code du travail), à présent car nous savons à quel point le risque d’agression serait décuplé pour les femmes si cette séparation n’avait pas lieu.
Alors dans notre cas que faire ? Il est tout à fait loisible à la jurisprudence de considérer que les transports et voyages non mixtes constituent un refus de vente pour une raison légitime en considérant l’impact du mouvement #Metoo qui a mis à jour les vastes manquements de l’Etat français pour protéger les femmes contre les actes de harcèlement qu’elles subissent au quotidien de la part des hommes.
D’autant que dans les faits, ces services réservés restent fortement minoritaires et qu’il est fort improbable qu’un homme puisse se retrouver sur le bord de la route sans véhicule du fait de l’existence de compagnies de taxis réservées aux femmes. L’évaluation d’une discrimination devrait donc toujours s’accompagner d’une étude factuelle et propsective pour déterminer si la discrimination constitue un réel dommage pour le groupe discriminé, et si le risque que dommage il y ait dans un futur proche soit réel. On imagine mal ce genre de compagnies pulluler vu qu’il s’agit tout de même de démarrer une activité en se séparant de la moitié d’une clientèle, voire aussi de la clientèle féminine qui souhaite toujours côtoyer des hommes. La meilleur preuve de la nécessité d’évaluer le dommage fait au groupe potentiellement discriminé est qu’à ma connaissance, aucune plainte n’a été déposée par des hommes contre ces services réservés et que si litige il y avait, il serait sans nul doute largement fabriqué, soit par une association politique, soit par un professionnel du droit curieux d’avoir l’avis d’un juge ou tenté de se faire de la publicité.
Plus surement, les juges, conservateurs par nature (même ceux classés à gauche, pour les raisons expliquées ci-dessus), considéreraient que le risque de dérives serait trop grand et que la tradition universaliste française ne peut tolérer ce genre d’exceptions. Tradition universaliste qui, quand elle a éclos à la Révolution (en excluant les femmes, bonjour Olympe de Gouges) était une idée progressiste, conceptualisée pour défendre les oppressés et qui aujourd’hui est utilisée contre les oppressées. Nouvelle démonstration s’il en était besoin, que la faiblesse essentielle du conservatisme politique réside en ce qu’il se retrouve toujours à défendre le progressisme d’hier.
A lire aussi sur Médiapart
.
30 décembre 2019
Utopie pénale : l’IGPN citoyen article 73
.
L’année écoulée a laissé place à un constat sans appel : les violences policières ont explosé à la suite du mouvement des gilets jaunes, et le gouvernement, dans le déni, loin de vouloir remédier au problème, semble au contraire l’encourager. Que peuvent faire les citoyens face à cela?
Avant-hier, mon Confrère Arié Alimi tweetait : « Le moment où user de la légitime défense contre des milices est peut être venu #LégitimeDéfense ».
Par ce mot de « milices », il désignait évidemment des policiers en roue libre, cagoulés, casqués, ne portant pas leur numéro d’identification, et qui en profitent pour utiliser la force sans discernement, que ce soit avec leur matraque ou leur lanceur de balle de défense.
Nous avons tous vu ces images de policiers tirant au LBD ou au mortier de manière tendue. Souvenons-nous aussi de cette vidéo d’une de ces brigades d’intervention spéciale, non formées au maintien de l’ordre, et dont les membres tiraient à la queue leu eu au LBD, l’un d’eux juste après avoir fait feu, lâchant cyniquement « A voté! ».
Le gouvernement, parce qu’il donné carte blanche à sa police, en nommant notamment un Préfet de police ultra- dont certains pensent que sa place est à l’hôpital psychiatrique plutôt qu’à la tête de la police parisienne– , n’est plus en position de durcir le ton face à elle. Son administration, que ce soit l’IGPN ou les procureurs ne peuvent pas se permettre d’enquêter sérieusement sur les policiers qui ordonnent ou commettent des exactions. Sa seule réponse aura été d’augmenter les primes des policiers et de leur maintenir le régime spécial de retraite qu’il refuse au reste des citoyens, apeuré qu’il est d’être lâché par son seul rempart. Ce n’est plus la police qui sert son gouvernement mais le gouvernement qui sert sa police.
En ce cas pour les citoyens, que faire (comme disait Lénine)? Mon Confrère a parlé dans son tweet de légitime de défense. Immédiatement la droitosphère s’en est saisie et a hurlé à l’appel à l’insurrection. Outre que la Constitution de l’An I en son article 35 légitimait ce recours à la révolte quand le gouvernement violait les droits du Peuple, et que l’un des slogans des gilets jaunes pourrait finalement être « Du pain et la Constitution de l’An I », notre droit comporte une disposition singulière prévue par l’article 73 du Code de procédure pénale, dont s’était d’ailleurs prévalu Alexandre Ben Alla pour justifier ses interpellations place de la Contre escarpe :
« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
Cet article n’exclue en rien les policiers qui commettraient des violences illégitimes, par des gestes inappropriés ou une mauvaise utilisation de leurs armes, ce que nous voyons encore chaque semaine. Ces faits sont évidemment punis d’une peine de prison. Il est évident que l’on imagine mal une personne seule, même forte comme un Christophe Dettinger, être témoin d’une violence policière, puis capable d’extraire un individu policier de son dispositif pour ensuite aller le présenter à l’OPJ le plus proche (donc certainement un policier) qui s’empresserait de le faire arrêter pour violences contre une personne dépositaire de l’autorité publique.
Néanmoins, rêvons un peu dans ces colonnes et imaginons comment pourrait s’organiser une milice citoyenne qui souhaiterait utiliser à son avantage l’article 73 du Code de procédure pénale contre des policiers violents.
Le premier échelon d’un tel groupement constituerait des « éclaireurs », équipés de caméras frontales ou de téléphones qui suivraient à la trace spécialement les groupements supplétifs de policiers (CSI et BAC mobilisés ponctuellement pour renforcer CRS et Gendarmes mobiles) dont on a vu qu’ils étaient plus susceptibles de commettre des violences illégitimes, et qui sont aussi des cibles plus faciles pour être appréhendées du fait de leur absence de boucliers mais surtout de leur indiscipline. Ces éclaireurs attendraient donc d’être témoins d’un acte violent illégitime (coups portés à terre, tir tendu de LBD, grenade jetée et non roulée au sol) qu’ils s’emploieraient à signaler au second échelon du groupement que nous appellerons « voltigeurs ».
Une fois le policier violent identifié (encore une fois les supplétifs mobilisés ponctuellement pour le maintien de l’ordre sont plus facilement repérables que des CRS car ils n’ont souvent pas d’équipement spécifique, portent des casques de moto, des baskets ou des pantalons qui permettent de les identifier individuellement), le groupe de voltigeurs suivrait patiemment le policier et attendrait le moment propice pour l’appréhender et l’extraire très rapidement de son dispositif, idéalement pendant une intervention donnant lieu à de nouvelles violences et à de la confusion. Ce groupe de voltigeurs doit évidemment être constitué d’individus suffisamment forts physiquement pour agir fermement et rapidement, utilisant la surprise.
Enfin en dernier rideau, interviendrait un troisième échelon, le plus important en nombre ,« la turbe » (du latin « foule »), dont le rôle serait de très vite s’intercaler entre les voltigeurs en fuite avec leur appréhendé d’une part, et ses collègues qui chercheraient à lui porter secours d’autre part. Ce rôle est plus ou moins passif, il ne s’agit pas résister aux policiers mais de leur barrer la route pour ralentir leur capacité de réaction.
Une fois le policier violent mis en lieu sûr et dépossédé momentanément de son matériel. Il convient de le présenter à l’OPJ le plus proche. Là serait la difficulté matérielle et juridique.
D’abord parce que dans une manifestation qui dégénère, à fortiori avec une milice citoyenne qui serait quasiment considérée par la police comme un ennemi combattant, il est très difficile de localiser l’OPJ le plus proche. Et que même si c’était le cas, l’OPJ le plus proche serait sûrement le supérieur hiérarchique du policier appréhendé et il s’empresserait de le libérer au lieu de le placer en garde à vue, destin qu’il réserverait plutôt à ses appréhendeurs.
Une solution téléologique (c’est à dire qui consiste à interpréter la loi en fonction de la situation pour lui donner sa pleine signification et efficacité en rapport avec les faits) serait de considérer que l’OPJ compétent et surtout non frappé de conflit d’intérêt résiderait au siège de l’IGPN, 30 rue Hénard dans le 12ème arrondissement de Paris.
L’on dit souvent que le droit pénal est d’interprétation stricte, mais ce principe n’est en rien irréfragable et peut être renversé, d’autant qu’ici c’est moins le fond du droit pénal que la procédure qui est en cause. De plus concrètement, ceux qui utilisent cette disposition actuellement, les agents de sécurité, ne conduisent pas stricto sensu ceux qu’ils appréhendent à l’OPJ le plus proche mais se contentent d’appeler le 17, ce qui est parfaitement accepté par la jurisprudence.
Il va cependant sans dire que l’IGPN serait bien embarrassée d’une telle remise. Mais cette action, filmée, puis transmise aux médias, avec en sus la vidéo où l’on voit le policier commettre un méfait, mettrait une pression maximum sur la police, puis sur les magistrats saisis pour juger les appréhendeurs. Dans une telle audience, l’on voit mal comment l’article 73 du Code de procédure pénale ne pourrait pas être l’arme absolue pour obtenir une relaxe.
Au delà de cette utopie pénale qui imagine une manière inattendue pour les citoyens de contrôler sa police du fait de la carence de l’Etat, le gouvernement doit se ressaisir et s’interroger sur ce qui pousse certains de mes Confrères à utiliser des mots aussi durs envers la police ou à échafauder des utopies ou des plans légaux contre les policiers violents.
Tant que la police française ne sera pas sérieusement contrôlée (et c’est la base de notre pacte républicain qu’elle le soit et que plus généralement, le pouvoir arrête véritablement le pouvoir, et pas seulement de manière formelle en prévoyant le contrôle mais en ne le diligentant pas sérieusement), tant que le gouvernement récompensera la police toujours plus après chaque journée de répression, nous continuerons d’utiliser des mots durs, de parler de milices, de soudards, de prétoriens, de mercenaires à la solde pour désigner certains policiers et certains de leurs hiérarques dont le comportement relève de la répression organisée plutôt que de bavures involontaires.
Emmanuel Macron a bien dit « Ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. ». Ce ne sont pas les mots qui sont inacceptables, ce sont les faits.
A lire aussi sur Médiapart.
.
22 décembre 2019
Le débri de l’empire
.
Je suis appelé pendant ma permanence garde à vue pour assister un homme soupçonné de ne pas avoir respecté son obligation de justification d’adresse après avoir été inscrit sur un fichier de délinquants sexuels. Je vais rencontrer une personne particulière, enfanté par un monde englouti.
Il a un patronyme à consonance « française » (si tant est que cela est un sens de dire cela aujourd’hui) et un prénom plutôt oriental. Quand j’arrive au commissariat et que l’on me met en relation, je vois un petit homme qui semble avoir une soixantaine d’année, rabougri. Il parle français plutôt convenablement, et paradoxalement, sa diction fait que je ne comprends pas tout ce qu’il dit. Il a un type indien, et je comprends assez rapidement qu’il est un français de Pondichéry, cet ancien comptoir commercial français situé sur la rive sud est de l’Inde, devenue colonie, puis finalement cédé à l’Inde pendant la période de décolonisation dans les années 50 en laissant le choix aux habitants de garder la nationalité française. Je suis assez ému en pensant que j’ai en face de moi l’une de ces personnes que rien ne m’aurait destiné à rencontrer sans cette folie qu’aura été le projet colonial français.
Les faits qui l’ont amené à être mis aux arrêts ne sont pas banals. Il m’explique de façon décousue, toujours dans ce français à la fois correct mais obscur qu’il ne peut plus s’occuper de sa fille que son ex épouse l’empêche de voir et qu’il est venu demander à Élysée un rendez-vous avec le Président de la République pour lui exposer son problème.
Je lui fais répéter plusieurs fois pour être sur d’avoir compris et j’imagine la tête des plantons qui ont du l’éconduire sans ménagement, puis devant son insistance, lui passer les bracelets, vérifier son identité et constater qu’il figurait sur le fichier des personnes recherchées.
Il y a cet indicible naïveté dans son discours et sa démarche, qui fait qu’on ne peut pas le qualifier de fou, ni pour autant le trouver totalement sain d’esprit. Français d’un autre monde, à plusieurs milliers de lieues de Paris, il ne rentre définitivement pas dans les cases et je repense maintenant à l’air embarrassé de la jeune policière à qui a échu le dossier. Formellement, je m’assure que la procédure relative au fichier FIJAIS a bien été respectée, qu’il a reçu sa notification en sortie de prison, je note encore une fois qu’il a été notifié de ses droits bien en retard par rapport aux prescriptions de la loi et que rien ne le justifie. Je remplis moi aussi mes petites cases juridiques.
A l’issue de notre entretien, la policière vient nous chercher, et nous constatons tous les deux qu’il a un mal fou à monter les nombreux escaliers à cause nous dit-il d’une jambe cassée jamais vraiment soignée. Il halète à chaque marche. La policière et moi sommes désarmés face à cet homme qui bringuebale vers une audition que nous anticipons déjà complètement hors de propos. Je demande s’il a bien vu le médecin. « Pas encore ». Mais de toute façon pour être déclaré inapte à la mesure, il faut avoir la carotide tranchée et giclante, et encore.
L’audition n’est pas habituelle. Deux autres policiers y assistent, peut être parce que la policière est très jeune et qu’elle ne doit pas encore être titularisée, peut être aussi car le gardé à vue est comme une attraction. Il répète son histoire de demande de rendez-vous au Président, je rêvasse en pensant à ces temps anciens pendant lesquels on a du mal à s’imaginer aujourd’hui à quel point le Roi était loin d’être barricadé dans son château, et au contraire très accessible. Le Roi-Justicier, de Saint-Louis à Charles VII, recevait assez naturellement les bonnes gens qui venaient lui exposer leurs problèmes et leurs conflits quotidiens. Et en même temps, que dirait-on aujourd’hui d’un Emmanuel Macron avec qui l’on pourrait prendre rendez-vous tous les mercredi après-midi pour qu’il entende nos doléances? Sans doute l’accuserait-on de faire de la démagogie à vil prix, comme VGE quand il s’invitait à dîner chez les gens.
Il s’insurge d’être placé en garde à vue, ne comprend pas cet histoire de fichier, ne comprend pas qu’il a été condamné, accuse le juge de racisme, et je sens l’air narquois qui passe sur le visage des policiers, et même imperceptiblement sur le mien en réaction à cette accusation que plus personne ne veut entendre. Il hausse la voix, me fait sursauter en tapant sur sa chaise. Toute chose qui aurait normalement provoqué chez les policiers une réaction immédiate de tutoiement, de cris redoublés, voire de menace physique.
Pas là. C’est comme si les policiers, comme moi, se sentaient désarmés face à cet homme, français, parlant français, que nous ne comprenons pas et qui ne nous comprend pas. Comme je l’avais fais avant lui, le policier assistant, magnanime, lui explique que nous ne pouvons pas refaire son jugement, que nous avons compris qu’il n’avait pas bien saisi son obligation de justifier tous les six mois de son adresse au commissariat, que son domicile est vérifié et que sa garde à vue va cesser le plus rapidement possible. Je lui pose une dernière fois la question pour qu’il explique bien qu’il a compris qu’à présent, il doit faire une demande d’aide juridictionnelle au Tribunal à Porte de Clichy pour son problème familial, et pas s’adresser au Président de la République. Il dit qu’il a compris.
Mais il continue de passer par tous les états, semble vouloir créer un lien avec nous, puis se calme. L’audition se termine, il insiste pour la relire minutieusement, encore une fois dans cet apparent paradoxe d’aisance et de difficulté. Nous le faisons regagner sa cellule, il redescend les escaliers en se tenant bien à la rambarde. Avec la policière, nous n’osons pas le prendre par les bras pour l’aider, pas parce que nous avons peur de sa saleté (elle et moi en avons vu d’autres, et en garde à vue, tout le monde est sale car la privation de liberté salit le corps et l’âme), mais comme si nous ne pouvions le saisir, comme si décidément, il faisait partie d’une dimension parallèle. Cette dimension que l’on ne peut plus saisir aujourd’hui, et que l’on entrevoit que dans ces rencontres fortuites avec les esprits défigurés qui la peuplent.
Il y avait cet idéal fou et présomptueux, après que nos ancêtres aient ensemble livré bataille pendant deux longues et terribles guerres, de faire sortir du fumier de la colonisation quelque chose de meilleur. Un empire du droit et de la raison où nous aurions tous eu les mêmes droits et devoirs, dans ce territoire immense sur lequel le soleil ne se couchait jamais.
Mais nous n’avons jamais pu. Pas parce que ce projet universaliste était biaisé et que les droits et devoirs dans lesquels nous aurions été égaux étaient pensés et conçus par des blancs et donc impropres aux autres « races ». Mais parce que nous nous sommes dits qu’il serait plus facile d’abandonner ces territoires et ces peuples à leur sort pour mieux les dominer avec notre richesse, à distance.
C’est ce que je me dis chaque fois que je recroise comme dans une réminiscence némesienne ces débris de l’empire sur lesquels notre raison trébuche, qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu’à la métropole, qui crient comme un thaumaturge incanterait, « Je suis citoyen français! » ,mais qui n’ont même pas la chance qu’avaient, du temps de l’Ancien régime, les rares esclaves noirs parvenant en métropole d’être de facto affranchis, tellement ces mots, « citoyens » et « français », ont désormais si peu de sens.
Je regarde cet homme clopinant regagner sa cellule, en pensant que d’autres que nous l’arrêteront ou l’assisteront, puis s’en désintéresseront, qu’il finira par disparaître, que ses enfants et petits enfants oublieront peu à peu ce « port enseveli » qu’est le Pondichéry français, parce que les rides puis la poussière finissent toujours pas recouvrir les cicatrices les plus profondes, parce que même la terre qui nous porte finit toujours par oublier.
A lire aussi sur Mediapart.
.
14 décembre 2019
.Ma première permanence en droit des étrangers
.
Cette année je me suis formé avec l’école du barreau de Paris au contentieux de droit des étrangers et ai pu m’inscrire sur les listes d’avocats commis pour assister notamment les étrangers en séjour irrégulier lors des audiences qui décident de leur placement ou de leur maintien pendant un maximum de 90 jours en centre de rétention. La semaine dernière, j’ai vécu ma première audience.
Pour assister des étrangers devant le Juge de la liberté et de la détention pendant une permanence, nous sommes gâtés. Contrairement aux comparutions immédiates en pénal, le dossier nous est envoyé la veille à 17 heures par le réseau privé virtuel des avocats.
Je reçois mes trois dossiers comme prévu et je me suis préparé à passer ma soirée avec beaucoup de café à annoter mes pdf, à rédiger des conclusions de nullité et des requêtes pour demander la main levée du placement en rétention. Ici, je vois une interpellation peu circonstanciée, ici un manque de diligence de l’administration pour solliciter des laisser passer, là une possibilité d’appeler une famille pour obtenir des garanties de représentation et solliciter une assignation à résidence plutôt qu’une rétention.
Je suis très scolaire, c’est ma première perm en droit des étrangers. Je vais me coucher à minuit pour arriver comme prévu à 9 heures et consacrer 20 minutes d’entretien aux trois personnes qui sont derrière ces dossiers avant l’audience qui commence à 10 heures. J’ai mon petit manuel de droit des étrangers sous le bras et je me dis que même si je n’ai pas encore les réflexes des confrères rompus à la matière, je vais pouvoir organiser une défense utile.
Et là patatra, première désillusion, la Consoeur référente de la perm me donne trois dossiers qui ne sont pas ceux que j’ai travaillé la veille. A ce qu’il paraît cela arrive souvent, quand les retenus refusent d’être extraits du CRA pour aller à l’audience. On sélectionne alors d’autres candidats et advienne que pourra. J’ai donc une heure pour analyser trois dossiers et voir les trois personnes. Absolument impossible. Réaction de dépit, de révolte, mais je ne peux ni demander renvoi, ni me soustraire à la permanence. Le juge doit statuer dans les 48 heures de la saisine par le Préfet quoi qu’il en coûte. Sinon on est obligé de remettre en liberté. Et ça c’est inenvisageable.
J’appelle au téléphone le greffe qui me rappelle de mauvaise humeur que l’audience est à 10 heures et que je dois être prêt. Je parcours en vitesse les dossiers. Mes réflexes de pénalistes reprennent le dessus, je note des retards de notification au Procureur et au retenu, je rédige des conclusions de nullité en vitesse dont je ne connais que trop bien le résultat. Sur les notifications de droit et au procureur, la loi est ouvertement violée par les policiers, mais les juges du siège n’en ont cure.
Je vois les deux premières personnes que je dois assister. Il est 9h40. L’un est Albanais, il me dit que chez lui, rien n’y personne ne l’attend. Il a été alpagué gare du nord. A 15 jours près, son obligation de quitter le territoire prenait fin. Pas de chance. Il a déjà refusé une première fois d’embarquer dans l’avion qui devait le conduire en Albanie. Les pilotes n’embarquent jamais de personnes contre leur gré, ils sont seuls maître à bord de leur appareil et il suffit d’opposer une résistance pour être reconduit au CRA. Ensuite le Procureur vous poursuit pour ce refus qui est une infraction pénale, vous fait condamner, et pour peu que n’ayez pas un gros casier, vous prenez du sursis, et on a pas d’autre choix que de vous assigner à résidence, que vous désertez immédiatement. Vous en êtes quitte pour arrêter de traîner dans les gares, les métros, tous ces lieux où les policiers n’ont pas besoin d’arguer d’un comportement suspect pour vous interpeller et ou l’arbitraire, le contrôle au faciès règne en toute légalité.
La seconde personne est un Afghan, de Surobi, l’endroit même ou dix de nos soldats sont morts au combat contre les Talibans dans l’embuscade qui leur avait été tendue en 2008. C’est un « dubliné » du règlement européen Dublin qui impose que ce soit le pays par lequel une personne est arrivé qui soit compétent pour traiter les demandes d’asile. Il a déjà été prise en charge par les autorités allemandes, ce qui revient à ce que la France s’en lave les mains et fasse un retour à l’envoyeur.
Il est plus de dix heures, je descends à l’audience. Les interprètes ne sont pas contents après moi. Ils ont d’autres choses à faire, ils veulent que je passe mes dossiers au greffe au plus vite. Tout ce petit théâtre éphémère semble bien embarrassé de devoir exister. Je discute avec ma Consoeur de permanence qui me dit que sur deux de mes dossiers il n’y a « rien à dire », il y a des laisser passer et donc on ne peut rien faire. En droit des étrangers, le laisser passer des autorités consulaires de l’étranger semble être l’équivalent du cancer du pancréas en phase terminale.
J’explique au greffe que je vais devoir remonter avec l’interprète en arabe pour voir mon dernier client. En face, il y a les Confrères qui défendent la préfecture, dans cette procédure bâtarde entre procédure pénale et civile. Je leur transmets mes conclusions de nullité comme je l’aurais fait au Procureur dans une comparution immédiate.
L’audience débute, et là, moi qui croyais avoir tout vu en terme de justice expéditive avec les comparutions immédiates, j’assiste à des dossiers qui sont traités en moins de 10 minutes chrono entre le rapport du juge, le « réquisitoire » de l’avocat de la préfecture et la plaidoirie de l’avocat de la défense, le dernier mot du futur retenu, pressé par le juge pour passer « au suivant » dit sur un ton que Brel n’aurait pas renié. On est sur du tout terrain, une audience de pure forme. Ce jour là à ma connaissance, aucune personne n’est remise en liberté sur les 13 dossiers, et quand elles le sont, elles semblent l’être sur des critères pré établies à l’avance où il faut vraiment que l’administration ait manqué de diligence comme il faut avoir une artère tranchée et giclante pour être déclaré inapte à une mesure de garde à vue.
Je plaide mes dossiers, mes nullités qui sont évidemment jointes au fond (ce qui est une politesse judiciaire pour dire qu’elles seront rejetées), j’objecte que les droits de la défense et le principe du contradictoire ne peuvent être assurés avec des dossiers communiqués une heure à l’avance. Mes mots sont hésitants, mes gestes timorés, je suis déstabilisé depuis le début comme dans un combat où tout votre plan est foutu en l’air par un direct du droit en pleine face dont on ne se remet pas. Mais cela reste un combat où le dossier est un ennemi à abattre en armure dont il faut trouver la faille.Il faut parler pour tuer. Et pleurer ensuite.
L’ambiance est plus détendue et moins pesante qu’en pénal, les retenus n’arrivent pas menottés, et ils semblent tous serein, fatalistes sur leur destin. Mes deux premiers clients sont maintenus en centre de rétention. Je ne peux que leur serrer la main et leur souhaiter bon courage. Entre temps, je peux remonter avec l’interprète en arabe pour avoir un entretien rapide avec mon dernier client, un tunisien pour qui un avion est déjà réservé afin qu’il parte avec son frère qui est dans la même audience. Je lui explique les règles en cas de refus d’embarquer et je redescends avec lui pour que le juge puisse « traiter » son dernier dossier qu’il expédie comme on corrige une copie d’examen.
Pour la forme, je vais faire appel d’un des dossiers ou la justification du refus de mes conclusions de nullité m’apparaissait encore plus baroque que d’habitude. Il y a une permanence d’avocats à la Cour d’appel, donc au moins un Confrère pourra défendre mon point de vue.
Pour la forme oui. Je suis en train de lire le best seller de Francis Fukuyama « La fin de l’Histoire et le dernier Homme », dans lequel l’auteur prend le contre pied de Hegel et de ses interprètes marxistes en affirmant après l’implosion du bloc soviétique que la fin de l’Histoire politique n’était finalement pas la dictature du prolétariat mais l’avènement de la démocratie libérale qui garantit au citoyens des droits formels comme le droit d’être assisté d’un avocat, que sa cause soit entendue par un juge d’indépendant, d’avoir la parole en dernier. Je me dis que si la fin de l’Histoire se termine dans cette haute tour de verre de la Sublime Porte de Clichy qui regarde vers les nord et vers Roissy, et de laquelle je sors dépité à 13 heures, ce n’est assurément pas une happy end. Je me dis que finalement, ces droits garantis sont à la démocratie libérale, ce que la charité était à la France catholique d’Ancien Régime. Une façon de s’acheter une conscience à vil prix. Mais à la fin, il s’agit de défendre la frontière, le seul rempart du capitalisme qui permet de justifier les plus values faites sur le dos des damnés de la terre que l’on trouve beaucoup plus commode d’avoir délocalisé à des milliers de kilomètres plutôt qu’à quatre heures de marche de Versailles. Il est plus difficile d’aller se plaindre sous le fenêtre du Roi pour un Afghan que pour une parisienne affamée de 1789. Les capitaux peuvent et doivent voyager sans contrainte, surtout pas les Hommes.
Quand j’étais à la fac avec mes petits camarades, il y avait un idéal qui nous imprégnait quand nous faisions les concours de plaidoirie, quand nous nous passionnions pour les cours de procédure pénale et de libertés fondamentales. Cette idée que nous allions devenir avocat pour à notre petit niveau, livrer les batailles que personne ne voulait livrer. Que les gens de peu que nous voulions devenir pourrions être les grains de sels qui enrayeraient au quotidien le Léviathan et nous pensions nos mots suffisamment affûtés pour lui mener une implacable guérilla. Nous ne voulions pas croire qu’à force de regarder le Leviathan dans les yeux, « lui aussi regarderait au plus profond nous », et que sans gloire, sans violence, sans révolte, il ne nous laisserait d’autre choix que de faire partie de lui si nous avions la naïveté de croire que nous devions rester des auxiliaires de Justice.
La Consoeur référente à la gentillesse de me rappeler pour savoir comment s’est passé la fin de ma première permanence. Elle finit par m’encourager et me dire que comme en pénal, je m’y ferai. C’est bien ce qui me fait peur.
A lire aussi sur Mediapart.
.
13 juillet 2019
Rugy : La morale mais surtout pas la loi
.
Les débats autour de l’affaire Rugy se polarisent sur la morale et le homard brandi comme un épouvantail aristophobe qui serait le signe d’une « scandinavisation » de la société française (les Scandinaves apprécieront). Mais les révélations de Médiapart à venir sur les invités de ces dîners recadreront le débat vers le thème le plus important : Que dit la loi?
Car depuis le début de ce scandale, les commentateurs (et même Fabrice Arfi qui dit ne pas vouloir qualifier les faits) oublient soigneusement que le fait pour un parlementaire d’inviter des amis à sa table avec de l’argent public en dehors de tout contexte professionnel rencontre une qualification pénale : celle de détournement de fonds publics.
Le détournement de fond public est défini à l’article 432-15 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. «
Précisons que la Cour de cassation a récemment considéré que les parlementaires sont des personnes chargées d’une mission de service public (Car oui, un sénateur contestait être une telle personne, on se demande bien de quoi il pensait être chargé).
Le texte est limpide, mais halte là, dirons certains, le Président de l’assemblée nationale en tant que député, dispose non seulement d’une immunité parlementaire qui doit être levée par ses pairs pour répondre devant l’autorité judiciaire des infractions commises, mais aussi d’une inviolabilité pour les actes non détachables de ses fonctions.
En d’autres terme, François de Rugy n’est pas poursuivable et condamnable par l’autorité judiciaire pour les actes dont on estime qu’ils sont faits en tant Président de l’assemblée nationale dans le cadre de cette fonction, même en cas de levée d’immunité.
Et si d’aventure, la machine judiciaire commençait à se mettre en branle, l’on aura surement beau jeu de nous expliquer que même si les dîners étaient « informels », ils étaient donnés par le Président de l’assemblée nationale dans l’hôtel particulier mis à sa disposition, et qu’ils ne sont donc pas détachables de ses fonctions.
Pourtant à bien y réfléchir, cet argument reviendrait à absoudre du délit équivalent en droit des affaires d’abus de bien sociaux tout dirigeant d’entreprise qui donne des fêtes privées dans ses locaux professionnels avec l’argent de la société. L’on voit bien dans quel méandre on est entraîné avec ce qualificatif de dîners informels. On ne serait pas dans un cadre strict, mais ce serait quand même un peu du travail, dans une ambiance détendue. Toute liberté d’appréciation étant laissée au maître de maison.
D’un point de vue légal, il importe peu que la table du Président de l’assemblée nationale serve à des dignitaires étrangers ou des députés des homards et des grands crus dans un cadre professionnel. D’un point de vue moral, l’on peut s’interroger sur la puissance symbolique de ces mets dont les représentants publics pourraient se passer (en tout cas quand ils sont payés par de l’argent public) sans pour autant déshonorer leur table, la cuisine française recelant bien d’excellents produits et recettes moins tape à l’œil.
Ce qui importe légalement est de savoir si le Président de l’assemblée nationale a reçu des amis dans un cadre non professionnel et si ces réceptions ont été financées par de l’argent public.
Et s’il est prouvé que ces dîners étaient donnés hors de tout cadre professionnel avec des relations amicales du Président de l’assemblée nationale et de son épouse, je ne vois pas au nom de quoi, et sans risque pour moi d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse, François de Rugy ne devrait pas voir son immunité parlementaire levée pour être poursuivi du chef de détournement de fonds publics devant l’autorité judiciaire. Et n’oublions pas que la complicité peut être retenue pour cette infraction. On imagine que les invités qui ont participé à ces agapes avaient tout a fait conscience que les époux Rugy ne régalaient pas sur leur cassette personnelle.
En fait si l’on ne parle pas de cette infraction de détournement de fonds publics, c’est que nous avons déjà intérioriser que la démission est un déshonneur suffisant pour un tel cacique, mais aussi que jamais les parlementaires en majorité LREM ne lèveraient l’immunité parlementaire pour un pêché somme toute considéré comme véniel : « Servons la bonne cause et servons-nous » écrivait dans son journal intime Benjamin Constant. L’on s’apprête à nous jouer la corde sensible : Quel Français indépendant n’a-t-il pas fait passer sur la carte de la boîte un dîner au restaurant qui n’avait rien de professionnel?
Tout cela laisse à penser que d’ici à ce que la tectonique des plaques boute la France en Scandinavie, beaucoup de homards passeront encore sur les tables de la République.
.
28 février 2019
Indépendance des magistrats du siège : la grande illusion
.
La dernière décision de remise en liberté d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase prise par la chambre de l’instruction, composée de juges statutairement indépendants du pouvoir politique, suscite la défiance des Français. En effet, ils n’ont pas de raisons bien solides de penser que le siège des juges indépendants n’est pas éjectable.
L’on s’émeut souvent de la dépendance des magistrats du parquet envers l’exécutif pour voir dans la magistrature du siège un sanctuaire à l’abri de l’influence du pouvoir politique. Il n’en est rien. Malgré plusieurs réformes depuis la création du Conseil supérieur de la magistrature sous la IIIème République, les carrières et les nominations des juges « indépendants » restent sous contrôle.
Des « petits pois » à la « même absence de saveur » de Nicolas Sarkozy, à l' »institution de lâcheté » de François Hollande, les magistrats n’ont jamais été décrits par les présidents de la République qu’en des termes de mépris, pions interchangeables dont la seule utilité est d’entériner les décisions du pouvoir politique, d’interpréter la loi un minimum, et surtout de désamorcer autant que faire se peut toutes les affaires qui pourraient mettre en cause le pouvoir politique.
Depuis la formation de l’Etat français, le pouvoir judiciaire n’a jamais été vu comme un véritable pouvoir souverain mais comme un délégataire qui devait rester à sa place. Déjà, le chancelier Michel de l’Hospital au XVIème siècle haranguait les juges des anciens parlements parfois un peu trop frondeurs en ces termes : « Le roy fait une ordonnance, vous l’interprétez, vous la corrompez, vous allez au contraire : ce n’est pas à vous. Les juges qui ne se veulent conformer au législateur sont comme les vogueurs qui tirent au contraire du gouverneur, et partant font péricliter le navire ; ou comme le père de famille qui n’est obéi des siens en sa maison. »
Depuis la fronde des parlements d’Ancien Régime, de la quasi révolution de 1648 de l’Arrêt d’Union à la fameuse séance de la Flagellation sous Louis XV, le souci du pouvoir exécutif a toujours été de maintenir les institutions judiciaires sous contrôle et de ne surtout pas en faire véritablement un pouvoir séparé mais un commis dévoué.
Cette vision amoindrie de la puissance judiciaire est concrétisée par la Constitution qui la désigne comme une autorité et non un pouvoir indépendant. Le pouvoir procède de lui même, alors que l’autorité tient sa force d’un pouvoir supérieur.
Le débat sur l’indépendance de la Justice s’arrête souvent à l’arlésienne de la réforme du parquet que l’on voudrait enfin détaché de ses liens directs avec le pouvoir exécutif. Dans chaque affaire, la saisine d’un juge d’instruction, d’un juge de la liberté et de la détention, ou de tout magistrat du siège est souvent accompagnée d’un soupir de soulagement : enfin le dossier va pouvoir être examiné par un juge qui n’est pas à la botte du pouvoir politique, juge que l’on croit enfermé dans sa tour d’ivoire de vertu, dont la carrière est déjà toute tracée, et qui est donc absous des conflits d’intérêt, d’une hiérarchie et de toutes les tentations humaines qui pourraient l’amener à ne pas rendre un jugement en son âme et conscience, mais en fonction de contingences qui n’auraient rien à voir avec son serment.
Faut-il le rappeler, les juges du siège indépendants du pouvoir politique sont nommés par un organisme, le Conseil supérieur de la magistrature qui gère leur carrière, leur avancement, et les juge quand ils commettent des infractions disciplinaires.
Avec la réforme constitutionnelle de 2008, dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est étonnamment le seul haut fait d’un hyper président qui voulait tout contrôler, non seulement la question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée, mais enfin, le Conseil supérieur de la magistrature fut officiellement libéré de la tutelle du président de la République à qui l’on a retiré la présidence de l’institution.
Pourtant, ce retrait du président de la République ne change pas grand chose au contrôle du pouvoir exécutif sur les magistrats du siège pour au moins deux raisons :
La première raison réside dans le fait que la séparation entre les magistrats du parquet et du siège n’est pas hermétique. S’il existe bien deux formations distinctes au sein du Conseil supérieur de la magistrature pour nommer magistrats du siège et du parquet, beaucoup de parquetiers jugés méritants peuvent être proposés pour devenir magistrats du siège y compris à des places importantes et inversement. Ainsi, deux des cinq derniers premiers présidents de la Cour de cassation ont eu une carrière importante au sein du parquet (Vincent Lamanda et Pierre Truche). Il n’est pas rare que certains haut magistrats aient aussi travaillé dans des cabinets ministériels, soient ensuite nommés au Conseil constitutionnel (dont la nomination est hautement politique) car si le poste de magistrat interdit le cumul avec la plupart des mandats électifs, l’on ne voit aucun problème à ce qu’un magistrat ait pu travailler au plus près d’élus ou de personnalités politiques importantes ou puisse y travailler par la suite.
La porosité entre le parquet et le siège d’une part, et le siège et les milieux politiques d’autre part, est donc volontairement entretenue pour pouvoir proposer aux magistrats jugés méritants prébendes et postes prestigieux, dont l’octroi est conditionné par bien plus que des critères objectifs de qualité de jugement, de raisonnement juridique et d’aptitude professionnelle en général.
La seconde raison réside dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui devrait donc être constitué de membres au dessus de tout soupçon et de toute influence pour pouvoir gérer sereinement et de la manière la plus objective possible la carrière des magistrats qui dépend de leur aptitude à sélectionner les meilleurs juges afin de pourvoir les postes les plus importants.
Sans revenir sur la longue histoire du Conseil supérieur de la magistrature, il suffit de s’en tenir à la situation actuelle qui est très loin d’être satisfaisante, au regard des impératifs d’une démocratie moderne et des exigences des traités européens.
La formation qui nomme les juges du siège est composée de sept magistrats et de huit personnalités extérieures. Les magistrats sont donc en infériorité. Ce ne serait pas si grave, et après tout, cela protégerait les magistrats de l’entre soi et du corporatisme, si ce n’était que les huit personnalités extérieures sont presque toutes sous influence politique : Un conseiller d’Etat dont on sait que la navette entre cabinets ministériels et Conseil d’Etat ôte à cette institution une grande partie de son indépendance, et six personnalités nommés par le président de la République et les deux Présidents des assemblées parlementaires; Enfin, depuis 2010, un avocat nommé par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (sur proposition de son président, ce qui permet d’éviter que l’assemblée générale puisse porter son choix sur un candidat non envisagé) .
Sur les 8 personnalités extérieures, pour peu que la majorité au Sénat soutienne le gouvernement, six sont sous l’influence directe du pouvoir politique.
Cela sans compter que le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas un rôle proactif dans la nomination des magistrats pour la majorité des postes mais qu’il doit composer avec la direction des affaires judiciaires inféodée au pouvoir exécutif. Les propositions de nominations émanent de cette direction du Ministère de la Justice.
A lire aussi sur Mediapart
.
16 janvier 2019
Mon cahier de doléances pour la Justice
.
Alors que les états généraux de 2019 ont été ouverts dans un gymnase (Il faut croire que c’est mieux que l’Hôtel des Menus Plaisirs), des milliers de Français n’ont pas attendu d’être sollicités pour rédiger des cahiers des doléances. Voici les miennes pour ce qui concerne mon métier, même si je ne suis pas dupe d’un grand débat national qui devra forcément être bousculé pour être efficace.
Emmanuel Macron a bien pris soin de ne faire aucune allusion aux états généraux à l’ouverture de son grand débat national. Pour un pouvoir chancelant, une telle référence convoquerait forcément le souvenir de mai 1789, celui d’un roi posant des règles immédiatement contestées puis le déclenchement de la Révolution.
En revanche j’ai le sentiment qu’il ne s’écarte pas de l’idée originelle des états généraux tels qu’ils ont été pratiqués dans l’Ancien Régime du XIVème au début du XVIIème siècle.
Hier mes étudiants de première année ont bûché leur examen partiel d’histoire du droit sur un texte de Guy Coquille, grand juriste du XVIème siècle qui décrit les états généraux (institution à laquelle il a participé en 1560) ainsi :
« Auxdits états généraux, le roi propose la cause pour laquelle il a appelé son peuple, commande aux députés de s’assembler , conférer entre eux et dresser des cahiers généraux sur lesquels il promet de faire réponse et ordonner lois salutaires à l’État […] Une fois entendues les propositions qui lui sont faites de vive voix par les orateurs de chaque ordre et après avoir reçu les cahiers, le roi ordonne lois qui sont dites lois faites par le roi tenant ses états, qui sont lois stables et permanentes et qui par cette raison sont irrévocables sinon qu’elles soient changées en pareille cérémonie de convocation d’états. Toutefois plusieurs rois s’en sont dispensés. »
Cette description des états généraux au XVIème siècle est intéressante et correspond à l’idée que se fait le président de la République de son grand débat national : Le roi réunit ses états comme il réunit un conseil élargi sur des sujets qu’il a circonscrit et pas comme un contre-pouvoir avec qui il transige. Il promet d’entendre, de répondre mais in fine, il n’est pas lié aux demandes des états généraux et il prend la loi qui lui convient, quitte à de toute façon s’en délier quand c’est son bon plaisir. Le Prince est absous des lois.
Les états généraux au XVIème siècle étaient une sorte de remise à plat qui permettait de redonner un souffle de légitimité au souverain soit au début de son règne, soit en cas de crise politique majeure, et c’est là l’objectif du président ainsi que la tactique qu’il utilise depuis ses débuts en politique: Éteindre la contestation en provoquant un débat de pure forme pour ensuite dire à ses contradicteurs mécontents de ses décisions : « Nous en avons déjà discuté et vous étiez d’accord ».
Qu’à cela ne tienne, je jette mes doléances comme une bouteille dans une piscine, en ce qui concerne mon métier :
1- Accès pour l’avocat à l’entièreté du dossier de l’enquête dès le début de la garde à vue, tout en laissant une possibilité au procureur de limiter cet accès en le justifiant par écrit selon des critères établis par la loi.
2- Recours devant le juge de la liberté et de la détention à l’oral et/ou à l’écrit pour contester le bienfondé des limitations d’accès au dossier et pour contester dès le début de la garde à vue le bienfondé de la mesure afin d’éviter les détentions arbitraires.
3- Toutes les patrouilles de police doivent être équipées de caméras pour vérifier les conditions et les raisons objectives des contrôles et interpellations.
4- Les procureurs de la République ne doivent plus avoir le statut de magistrat et ne doivent plus occuper de position surélevée lors des audiences. Dans toute affaire impliquant un élu, un candidat à une fonction politique ou un dirigeant de parti politique, un procureur spécial choisi parmi les magistrats du siège devra être nommé par le Conseil supérieur de la magistrature.
5- Amener le budget de la Justice actuellement à 0,25% du PIB au niveau de celui de l’Angleterre et de l’Allemagne (0,40%), c’est à dire ajouter 4 milliards d’euros au budget actuel.
6- Élection au suffrage universel direct des juges du Conseil constitutionnel renouvelés par tiers tous les trois ans. Obligation pour les candidats d’être titulaire au moins d’un master II en droit. Éviction des anciens présidents de la République.
7-Revenir à des jury entièrement constitués de jurés non professionnels en Cour d’assises. Instaurer des jurys populaires pour tous les procès quelque soit la nature et le degré de l’infraction quand ils concernent un élu, un candidat à une fonction politique ou un dirigeant de parti politique.
8- Empêcher que les maisons d’arrêt ne dépassent 100% de leur capacité. Dès qu’un juge souhaite placer en détention provisoire un individu, un juge de la liberté et de la détention attaché à la maison d’arrêt choisie qui est en surcapacité devra évaluer quel(s) détenu(s) présentent les critères les plus adaptés à une mesure alternative à la détention (bracelet électronique ou contrôle judiciaire) pour faire de la place.
Voilà ce que je demande après quatre ans au Barreau de Paris. Quatre ans pendant lesquels j’ai vu les avocats pousser la porte de la garde à vue sans que leur avis de juriste ne soit réellement pris en compte dans la procédure à ce stade et sans qu’ils puissent demander efficacement la fin de mesures grossièrement illégales, des procès verbaux d’interpellations bidonnés, des procureurs transformés en robot ou en soldat, des greffiers qui font le job avec des bouts de ficelles, une justice instrumentalisée par la politique, des décisions du Conseil constitutionnel arbitraires fondées sur des jugements de valeur, des jury complètement anesthésiés et tenus en laisse par les trois juges professionnels, des prisons transformées en boîtes de sardines.
A lire aussi sur Mediapart
.
3 janvier 2019
Carlos Ghosn est-il pire qu’un terroriste ?
.
Le président de Renault et ex président de Nissan, citoyen français, est détenu sous un régime proche de notre garde à vue au Japon pour fraude fiscale et abus de confiance depuis le 19 novembre 2018. Peu de voix s’élèvent en France pour dénoncer une durée de détention peu conforme avec les normes internationales en vigueur.
Carlos Ghosn, est en garde à vue depuis près d’un mois et demi et pourra possiblement y rester jusqu’au 11 janvier prochain.
Il n’est pas un réalisateur ukrainien activiste embastillé par un pouvoir russe violent et autocratique, il n’est pas non plus un dissident australien enterré vivant dans une ambassade.
Il est un capitaine d’industrie richissime connu pour son rapport pour le moins décomplexé à l’argent et pour s’être imposé dans un pays considéré – à tort ou à raison- comme l’un des plus hermétiques du monde en ce qui concerne les affaires.
Il est accusé au Japon de ce que l’on appelle en France des délits en col blanc, fraude fiscale et abus de confiance.
En France, les auteurs ce genre d’infractions, bien que fort dommageables pour la société, obtiennent dans beaucoup de cas un régime de faveur par rapport à la délinquance de rue violente. Ils font rarement l’objet de détention provisoire avant procès, et encore plus rarement de peine de prison ferme sous prétexte d’être bien inséré et donc de fournir des garanties de représentation. Quand le gardé à vue est considéré comme une personne importante, la mesure est souvent aménagée comme dans le cas de Nicolas Sarkozy qui a pu rentrer chez lui pendant la nuit pendant sa dernière garde à vue.
On peut regretter que ces délits et leurs auteurs ne suscitent pas des mesures pre procès et une réponse aussi ferme que les infractions physiques de la part de l’État français. Néanmoins, peut-on se réjouir de voir Carlos Ghosn maintenu en garde à vue au Japon pendant près d’un mois et demi, sans accès à son dossier, c’est à dire sans connaître l’essentiel des charges qui pèsent contre lui?
En France cette période de garde à vue peut durer un maximum de 6 jours pour les crimes terroristes avec possibilité de différer l’arrivée de l’avocat. Au delà de cette période, le mis en examen a accès à son dossier et à toutes les investigations ultérieures qui sont faites. Il peut librement et efficacement travailler à sa défense avec son avocat.
Cette période sans accès au dossier est déjà très critiquable et critiquée dans notre pays comme contraire à la lettre de la directive européenne 2012/13/UE qui a été transposée partiellement par la loi du 27 mai 2014 en la vidant de sa substance. Cette transposition a été honteusement confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2016 . En matière de garde à vue, nous vivons toujours sous une réminiscence de l’Ancien droit, quand la reine des preuves était l’aveu et quand tous les moyens étaient bons pour l’extorquer.
Au Japon, nous aurons donc appris que l’on peut rester, pour chaque infraction, un maximum de 23 jours en garde à vue sans accès à son dossier. Sachant que dans le cas de Ghosn, le procureur japonais, s’est gardé des cartouches en réserve en ne le poursuivant pas dès le début pour toutes les périodes et pour tous les faits qu’il entendait investiguer.
C’est exactement comme si dans le cas de l’affaire Bygmalion , le parquet avait requis non pas pour l’ensemble de la fausse facturation mais morcelé la poursuite pour chaque fausse entrée. Il aurait ainsi pu procéder à 48 heures de garde à vue pour chaque fausse facture et harceler les responsables jusqu’à ce que de guerre lasse, ils finissent par avouer.
Le Japon n’a certes pas à s’embarrasser de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des directives de l’Union européenne. Mais cette pratique apparaît tout de même contradictoire avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dont est signataire le Japon, qu’il a ratifié le 21 juin 1979, et auquel il confère une valeur supralégislative : En d’autres termes, les juges nippons doivent l’appliquer directement dans leur droit et le faire primer sur leur loi nationale.
Ce pacte dispose notamment :
« Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. […]
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.[…]«
Ce pacte reprend les grandes lignes du droit au procès équitable, du principe de légalité des délits et des peines, et de l’interdiction des détentions arbitraires et indignes qui sont les principales avancées pensées par le mouvement européen des Lumières et mis en place dès le XVIIème siècle en Angleterre et à la fin du XVIIIème en Amérique et en Europe.
Dans notre cas, nous parlons d’une détention qui a déjà duré près d’un mois et demi, avec un organe de poursuite qui détourne son droit, pratiquant un réquisitoire en forme de supplice chinois pour s’arroger le temps de garde à vue le plus long possible afin de faire craquer psychologiquement un mis en cause et l’empêcher de connaître la date exacte ou approximative de son élargissement.
Nous parlons aussi de l’absence d’accès au dossier, ce qui ne permet pas au gardé à vue de connaître les raisons étayées de sa détention. Dire à Ghosn qu’il est en garde à vue pour fraude fiscale et abus de confiance n’est pas si éloigné de dire à Sentsov qu’il est en détention pour « préparation d’acte terroriste ». Si vous ne fournissez au gardé à vue aucun élément étayé à l’appui de vos accusations, alors lui donnez-vous vraiment les raisons de cette arrestation au sens du Pacte précité?
Il est assez déconcertant de voir avec quelle bonhommie nos commentateurs nationaux traitent ces violations qui touchent un concitoyen, comme si nous avions à faire à une spécificité culturelle japonaise qu’il faudrait respecter comme on respecte les mœurs bizarres de bons sauvages. Quant à l’État français, il a très rapidement lâché Ghosn qui est donc l’exemple vivant (parmi tant d’autres) qu’il est fort peu utile de dire « je suis citoyen français » quand on est en détresse à l’étranger.
Le Japon est une démocratie, les juges qui prolongent cette mesure sont indépendants. Il est signataire des grands pactes internationaux onusiens qui garantissent l’existence d’un État de droit. Il se montre aujourd’hui indigne de son rang.
Je comprends bien que Carlos Ghosn puisse attirer moins de sympathie que Florence Aubenas ou Julian Assange. Qu’on ne monte pas de comité de soutien pour lui ou qu’on affiche pas son portrait en grand sur l’Hôtel de ville à Paris. Je comprends bien qu’un ouvrier aurait pu travailler pendant tout le Mézosoïque pour gagner un mois de son salaire. Mais il n’en reste pas moins un être humain et un concitoyen qui a le droit à ne pas subir une détention arbitraire et indigne dans l’indifférence générale.
A lire aussi sur Mediapart
.
17 décembre 2018
Garde à vue : L’interdiction faite à l’avocat de poser des questions
.
« Maître, des questions? »
« Oui, une, pour le plaignant ».
« Ah non Maître, les questions c’est simplement pour votre client et personne d’autre, on est pas dans le bureau du Juge ici. »
Scène de plus en plus habituelle dans les commissariats en garde à vue qui, la dernière fois que je l’ai vécue, s’est poursuivie par une lecture de la lettre de l‘article 63-4-3 du Code de procédure pénale, et d’une réponse surréaliste de l’OPJ me lisant les opinions d’un Confrère niçois sur le site Legavox et qui écrit, de façon bien malheureuse : « Également, au terme de ladite audition, l’Avocat à (sic) la possibilité d’interroger lui-même son Client sur des points qui n’auraient pas été évoqués ou bien pour reprendre des réponses qui pourraient être mal interprétées. »
Legifrance contre Legavox , Légifrance a fini par l’emporter, cette fois, pour la suite de la confrontation.
Les policiers sont parfois bons connaisseurs de la procédure pénale car elle fait évidemment partie intégrante de leur métier. Certains gardiens de la paix ont passé le bloc OPJ, examen de procédure pénale qui leur permet d’obtenir la qualification OPJ sans faire partie du corps des officiers de police (lieutenants, capitaines, commandants). En revanche, d’autres suivent aveuglément des consignes hiérarchiques qui violent la loi.
S’il est vrai qu’en application de l’article précité « L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête » et que « Mention de ce refus est portée au procès-verbal », l’ enquêteur qui mène son audition ne saurait dire à l’avocat à qui il n’a pas le droit de poser ses questions. S’il refuse de consigner les questions de l’avocat, il doit expliquer dans le procès verbal, en quoi celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête, afin qu’un juge puisse se prononcer sur l’opportunité d’une telle opposition.
Mais pourquoi le fait, pour l’avocat d’un mis en cause, d’interroger un plaignant ou l’enquêteur en confrontation, c’est à dire d’exercer le principe fondamental du contradictoire et de l’égalité des armes, peut-il nuire à l’enquête?
Bien sûr, il est du devoir de l’enquêteur de s’opposer à des questions hors-sujet, dilatoires, ou qui constitueraient des menaces voilées, mais le refus arbitraire fait à l’avocat de contre interroger une personne autre que son client est non seulement illégal, mais aussi kafkaïen. Il fait penser aux moments lors des séances de questions au gouvernement, où un parlementaire de la majorité pose des questions à un ministre, souvent sans intérêt, dans le seul but de décliner les éléments de langage de l’exécutif, et de créer l’illusion d’une séparation des pouvoirs.
La garde à vue post arrêts de la Cour de cassation d’avril 2011 constitue une illusion similaire : le contradictoire y a été imposé au forceps, mais il reste un decorum dont la police peine même à s’accommoder en dressant un cordon sanitaire entre le cœur de la procédure et l’avocat. L’essentiel reste toujours à conquérir: L’accès à toutes les pièces du dossier en possession des enquêteurs dès le début de la mesure pour pouvoir travailler dès cet instant sur la forme et le fond de la procédure, et l’accès au recours à un magistrat indépendant, qui soit en mesure de suspendre ou d’annuler la garde a vue quand il la juge abusive, afin que nul ne puisse être privé arbitrairement de sa liberté d’aller et venir. Sans cela , la garde a vue restera davantage une survivance des pratiques d’Ancien Regime qu’une mesure de privation de liberté temporaire moderne et raisonnable.
Car tout se passe toujours comme si le fait d’être enfermé en étant toujours considéré comme innocent était un dommage collatéral nécessaire au travail de la police qui était acceptable, car contestable a posteriori dans la procédure. Mais quid des procédures qui sont terminées par un non-lieu ou un rappel à loi décernés selon la décision du procureur de la République?
Là est la réalité : En 2018, toute personne peut être enfermée et soumise au bon vouloir de la police et d’un procureur dépendant du pouvoir exécutif pendant 48 heures, sans qu’un avocat puisse saisir un juge indépendant afin qu’il se prononce sur la pertinence des soupçons qui pèsent sur son client et sur l’opportunité de sa privation temporaire de liberté, et sans qu’il puisse ne serait-ce que poser des questions jugées gênantes, mais qui seraient pourtant une maigre compensation à l’absence d’accès au dossier .
Les récentes mésaventures de Julien Coupat pour possession d’un masque de chantier et de bombes de peinture ainsi que l’utilisation détournée de la garde à vue pour embastiller préventivement des présumés fauteurs de trouble en puissance le démontrent : La garde à vue reste encore aujourd’hui une véritable lettre de cachet moderne.
A lire aussi sur Mediapart
.
9 octobre 2018
Jeune commis d’office, bienvenue dans le monde merveilleux du droit de suite
.
« Voilà, vous allez probablement être déféré au Tribunal devant le Procureur qui décidera de la suite de la procédure »
« Est-ce que vous serez là aussi ? »
« Non, ce sera un autre avocat. Car je dois demander le droit de suite au Barreau et j’en ai déjà eu un le mois dernier. Il me sera donc sûrement refusé. Mais vous aurez un avocat de permanence qui reprendra très bien le dossier »
« Mais à quoi ça rime ? Vous m’avez suivi pendant toute la garde à vue, et maintenant c’est un autre qui va me défendre ? »
Ça rime à quoi en effet, dans le regard penaud du gardé à vue, à qui l’on tente d’expliquer en quelques mots à la sortie d’une audition, la tambouille des avocats? Bienvenue au pays du droit de suite, expression couramment utilisée en droit des contrats pour décrire la possibilité pour un créancier d’exercer une demande sur un bien qu’il avait grevé d’une hypothèque.
Dans le monde des pénaleux du barreau pénal à Paris, cela signifie que chaque avocat qui a été commis pour défendre un gardé à vue doit faire une demande écrite au délégué du Bâtonnier qui doit y répondre positivement pour continuer à le défendre après son déferrement et son éventuelle mise en examen ou renvoi devant le Tribunal, et ce même si le gardé à vue a choisi de continuer avec son avocat et/ou souhaite le payer sur ses propres deniers.
Bienvenue dans un monde où comme les migrants qu’on embarque, qu’on débarque et qu’on se répartit, comme les vieux qu’on envoie dans les limbes des maisons de retraite cotées en bourse, les gardés à vue sont gérés comme un gisement à préserver que le Barreau de Paris s’est donné pour mission de répartir entre les avocats commis d’office.
Pour se faire, il commet deux délégués dédiés à cette tâche évidemment impopulaire et pour laquelle ils ne se font pas que des amis dans le petit monde du pénal. Et quand on les interroge timidement sur cet état de fait, la première raison qu’ils avancent est la nécessité pour le Bâtonnier de s’assurer que les avocats commis d’office sont bien de taille à gérer une affaire sensible et complexe car quand le Bâtonnier commet un avocat, il s’engage à ce que le travail soit bien fait. Il ne faudrait donc pas qu’un trop jeune avocat soit commis imprudemment sur une affaire qui dépasserait sa compétence.
Mais alors, l’on se demande bien à quoi sert la fameuse Ecole de la défense pénale, dont les quelques centaines de places sont prises d’assaut tous les débuts d’année par les jeunes avocats désireux de pouvoir suivre les cours dispensés par les meilleurs pénalistes de la capitale et de sa banlieue, et ainsi obtenir le sésame pour s’inscrire sur les listes pénales du Barreau de Paris ?
A quoi sert encore de devoir suivre douze heures de formations annuelles en droit pénal si cela ne suffit encore pas à ce que le Bâtonnier ait toute confiance en chaque avocat qu’il commet dès le début d’une procédure ?
Sans compter que les affaires les plus sensibles et compliquées sont préemptées par les douze secrétaires de la Conférence, lauréats annuels d’un concours de plaidoirie qui les rend prioritaires (et légitimes) pour assurer les commissions d’office en matière criminelle.
Alors, peut-être, quelqu’un à l’Ordre ou ailleurs, vous fera-t-il la confidence que les gardés à vue ne sont qu’un gros gâteau, que ce gâteau (malheureusement pour les avocats, heureusement pour l’ordre public) ne grossit pas, et que chaque année, le nombre de convives à la table augmente. Que dès lors, il faut sélectionner, et distribuer à chacun ce qui lui est dû.
On imagine la difficulté de la tâche. Et aussi l’embarras journalier qu’une telle besogne cause. Bien sûr, les commissions d’office représentent pour beaucoup d’entre nous un complément financier salutaire malgré le faible revenu qu’elles procurent.
Mais qui peut croire que l’avocat qui suit un dossier de la garde à vue à la condamnation n’est pas perdant économiquement quand il fait son travail correctement, qu’il soulève tous les points problématiques du dossier, fait des demande de mise en liberté, et visite le plus régulièrement possible son client en détention ? Qui peut croire que l’engouement romantique provoqué par la matière survit à la réalité de l’exercice de la défense pénale au quotidien ?
Ceux d’entre nous qui souhaitent suivre les gardés à vue jusqu’au bout de leur périple judiciaire sont animés par le besoin de ne pas se voir transformés en simple travailleurs à la chaîne dépossédés des dossiers pour lesquels ils se déplacent à toutes heures du jour et de la nuit, parfois pour endurer de longues auditions pendant lesquelles ils ne peuvent pratiquement pas intervenir. Le véritable travail juridique commence après la fin de la garde à vue, à l’obtention du dossier, dont le chemin demeure barré par un droit suite refusé dont on ne cesse de nous préciser qu’il nous est conféré à titre exceptionnel.
Et bien sûr, pourquoi le nier, nous sommes aussi motivés par la nécessité de nous constituer une clientèle. Sinon comment les jeunes avocats qui ne travaillent pas pour des pénalistes installés sont censés procéder ?
Nous ne traînons pas dans des bars de bandits en laissant tomber nos cartes de visites et en levant le coude avec des braqueurs et des dealers pour leur proposer de blanchir leur argent et de passer des téléphones portables en prison.
La seule façon pour un jeune avocat de grandir sereinement, c’est d’enchaîner les dossiers comme commis du début à la fin, avec la confiance du Barreau et la faible mais protectrice rémunération de l’État, afin d’être à l’abri dans un premier temps, des propositions de paiements somptuaires en rémunération d’un labeur qui n’aurait rien à voir avec ses talents juridiques.
Au-delà de mes états d’âmes, comment ne pas voir que ce système débouche sur des situations kafkaïennes avec des permanences pénales souvent surchargées, des avocats d’astreintes appelés au dernier moment qui ont quelque fois la chance de se faire expliquer deux minutes un dossier par un confrère ou une consœur qui aura demander le droit de suite, et qui ne voyant pas de réponse venir, aura quand même suivi jusqu’au bout le justiciable pour passer le relais dans de bonnes conditions?
Il existe même des situations où le droit de suite trouve à s’appliquer alors même qu’aucune permanence dédiée n’est prévue, comme lorsque le parquet délivre une convocation par procès-verbal assortie d’une réquisition de contrôle judiciaire. Certaines personnes, défendues par un avocat en garde à vue, et persuadés de pouvoir être assistées par lui ou au moins par un autre Confrère, se retrouvent donc seules devant le juge de la liberté et de la détention qui peut les astreindre à de sévères obligations de contrôle, car le Barreau n’a pas prévu de permanence pour cette procédure. Et c’est seulement si l’avocat de garde à vue a demandé le droit de suite et se l’est vu refusé que l’on daignera rappeler en catastrophe la permanence « JLD », concentrée sur les audiences qui font suite aux mises en examen.
Comment ne pas constater ainsi la désorientation des justiciables qui ont l’impression d’être des patients allongés sur lesquels se disputent plusieurs barbiers chirurgiens ?
Le droit de suite est une aliénation qui pèse aussi bien sur l’avocat commis d’office que sur les justiciables. Et si l’on ne saurait nier que de plus en plus d’avocats sont attirés par les permanences de garde à vue et qu’il faut donc réguler cet afflux dont on peut pourtant toujours se réjouir, combien après quelques mois, ont véritablement le temps, l’énergie et la motivation pour se consacrer pleinement à une carrière de pénaliste et pour suivre les dossiers jusqu’au bout, même les moins rémunérateurs, avec les justiciables les plus en difficulté sociale ?
J’ai la conviction que si le Barreau faisait le choix de baisser le nombre de jours de gardes par mois, et dans le même temps abolissait le droit de suite ou tout du moins choisissait de l’accorder par principe et non par exception, la Confrérie ne s’en porterait pas plus mal, et que comme toujours, notre bonne Thémis ferait le tri entre les nombreux impétrants, et les quelques élus.
.
13 août 2018
Affaire DisinfoLab : A quand la loi sur les true news?
.
Le possible fichage politique des citoyens français via leur utilisation des réseaux sociaux en violation de la loi informatique et libertés a moins ému le gouvernement français qu’elle ne lui a permis d’agiter à nouveau le fantasme de l’ingérence russe et de son armée de hackers, claviers entre les dents, prêts à tout pour déstabiliser la France et les pays occidentaux.
Pour rappel l’ONG belge DisinfoLab avait publié une étude qui montrait qu’un nombre « anormalement » élevé de tweets avaient été émis en seulement 17 jours sur l’affaire Benalla et avait par la suite pour se justifier, publié une classification des comptes twitter en fonction de leur obédience politique supposée.
Tandis qu’une majorité de citoyens et d’hommes et femmes politiques s’étaient émus de ce fichage politique, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, avait demandé que toute la transparence soit faite sur ces messages, et appuyé une tentative par le groupe de centre droit Agir de détourner l’objet de la commission d’enquête au Sénat pour que celle-ci se saisisse de «la manipulation attribuée aux comptes russophiles sur Twitter pour déstabiliser l’exécutif français.». Pour le gouvernement, l’objectif est clair: Il faut développer la narration selon laquelle une grande partie des tweets ayant eu trait à l’affaire Benalla puisse être le fait de comptes « russophiles » ou de bots liés à la propagande russe, c’est-à-dire de faux comptes automatisés qui permettent de maximiser la médiatisation d’une information. Ce faisant, et bien que cette possibilité ait été largement démontée, il remettait une pièce dans la machine à « ingérence russe » qui avait notamment servi de chiffon rouge pour justifier la loi sur les fake news.
Celle-ci a été largement mis en branle à la suite des Macron Leaks, c’est-à-dire le piratage des courriels des membres de l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron par des auteurs inconnus mais soupçonnés par les services secrets américains de faire partie de la nébuleuse Fancy Bear, groupe de hackers possiblement liés au renseignement russe.
Cette information, aussi anxiogène qu’invérifiable, a pourtant des répercussions bien réelles sur les relations internationales et sur les lois nationales adoptées en conséquence : La défaite d’Hillary Clinton à la dernière élection présidentielle américaine est largement attribuée à une ingérence russe, tout comme les Macron Leaks et ce, sans que le moindre élément tangible qui pourrait le prouver ait été présenté au public, les services de contre espionnage occidentaux demandant à leurs citoyens de les croire sur parole.
C’est assez paradoxal quand nous savons que le gouvernement français a en revanche toutes les preuves, grâce à l’action du lanceur d’alerte Edward Snowden, que lui, ses citoyens, et ses entreprises ont été massivement espionnés par la NSA américaine et le GCHQ britannique, et qu’absolument aucune mesure de rétorsion n’a été prise, ni de grand débat national enclenché.
Assez paradoxal aussi de reprocher à la Russie de préférer un candidat conforme à ses intérêts géopolitiques, François Fillon ou Marine Le Pen en France, et Donald Trump aux Etats-Unis, en utilisant tous les moyens médiatiques et numériques (hors piratages informatiques) à sa disposition, alors que les Etats-Unis eux non plus ne se privent pas d’utiliser de telles méthodes : Personne ne reproche à Radio Free Europe d’être un agent déstabilisateur.
En revanche, la loi sur les fake news a pourtant été adoptée, nonobstant le fait qu’au fond, les Macron Leaks étaient avant tout une true news et qu’ils ont même permis de trouver des courriels assez inquiétants concernant Alexandre Benalla.
Vu le timing de cette révélation (juste avant le 1er tour de l’élection présidentielle 2017), les journalistes français ont pris beaucoup de précautions pour s’assurer que des faux courriels n’avaient pas été insérés et personne ne peut dire que les Macron Leaks ont été instrumentalisés malgré la faible tentative de Marine Le Pen pendant le débat d’entre deux tours.
Ce qui risque de rentrer dans le collimateur des décideurs marchiens, ce ne sont donc plus seulement les fake news, mais les vraies informations critiques de la politique du gouvernement dont la médiatisation serait maximisée par tous les moyens automatisés que permet la société numérique.
Comme si dans l’esprit des membres du gouvernement, il était acceptable qu’un milliardaire quelconque puisse maximiser la médiatisation des informations qui lui conviennent en achetant des titres importants de la presse française, mais qu’il était inacceptable que des cyberactivistes puissent, avec ou sans argent, profiter des possibilités que leur offre internet pour gonfler l’audience d’une vraie information qu’ils jugent importante.
Vu les difficultés pratiques et légales de savoir qui se cache derrière ces comptes automatisés, le bouc émissaire russe pourrait donc être largement utilisé pour mettre en place une nouvelle infraction, dont je propose, dans une tentative d’ingénierie juridique-fiction, d’imaginer quelle pourrait en être la rédaction :
« Le fait pour toute personne physique ou morale d’utiliser, de mettre en place, ou d’aider à la mise en place de moyens numériques déloyaux pour augmenter artificiellement la diffusion d’une information est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. »
Ici, les mots « déloyaux » et « artificiellement » participent à une rédaction qui doit être aussi floue que possible pour que des procureurs intelligents qui écoutent ce qu’on leur dit puissent s’abstenir de poursuivre les personnes qui relayent les informations en faveur du gouvernement (les militants marchiens étant loin d’être en reste quand il s’agit de diffuser à grande échelle et avec des faux comptes les éléments de langage gouvernementaux) et se concentrer sur les comptes « russophiles ».
Certes les principes à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi, ainsi que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale sont censés nous prémunir contre ce genre de dérive, mais quand on a constaté ces dernières années tout ce qu’il est possible pour l’autorité administrative d’interdire (manifestations, supporters, port d’un voile sur une plage) en brandissant le concept tout terrain d’atteinte à l’ordre public, nous pouvons quand même nous inquiéter des mesures que prendra le gouvernement pour que plus jamais, une simple « affaire d’été » ne puisse le contrarier à ce point.
.
4 août 2018
Destitution du Président de la République : La peur du vide?
.
Quand les blés sont sous la grêle, Fou qui fait le délicat ! » Ainsi André Chassaigne a ouvert son discours au soutien de la motion de censure du 31 juillet dernier pour proposer le renversement du Gouvernement Philippe à la suite de l’affaire Macron-Benalla.
Tout comme les femmes et hommes communistes coincés dans une galaxie poétique en deuil depuis la disparition de Monsieur Triolet, les députés d’opposition semblent condamnés inlassablement à pousser le rocher de la motion de censure en haut de la colline de Matignon en sachant pertinemment qu’il en redescendra.
Mais ce jour-là, André Chassaigne fut le premier à esquisser une tentative de sortie de cette boucle infernale, sans doute en réponse à la foucade jupitérienne « Qu’ils viennent me chercher ! ». Je le cite, in extenso :
« Certes, la Constitution de la Ve République est particulièrement protectrice – et il le sait – à son égard, puisque, selon l’article 67, « le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ». Une irresponsabilité de principe qui ne saurait omettre l’hypothèse évoquée par l’article 68, lequel prévoit : « Le Président de la République […] peut être destitué […] en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. Dès lors, si les diverses enquêtes ouvertes devaient montrer que les actes commis par Emmanuel Macron constituaient un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », il appartiendrait à la représentation nationale de s’interroger quant à l’opportunité d’enclencher cette procédure de destitution. Le fait, notamment, de ne pas avoir directement ou indirectement demandé à saisir le procureur de la République, comme l’y obligeait l’article 40 du code de procédure pénale, pourrait fonder ce manquement.»
Alors que les députés de la majorité n’avaient cessé d’interrompre André Chassaigne, le silence se fit dans l’hémicycle devant cette sourde menace qui confine quasiment au crime de lèse-majesté. Le réalisateur cadra alors sur Le Premier Ministre qui esquissa un sourire contrit comme pour conjurer l’incantation.
Car comme le rappelait André Chassaigne, depuis la révision constitutionnelle de 2007, le Président de la République peut être destitué de son mandat pour une raison autre que la haute trahison, objet juridique non identifié porté alors par une loi constitutionnelle de 1875, qui semblait toutefois aux yeux de tous circonscrire la responsabilité du Président de la République à une intelligence avec une puissance étrangère. Le cas s’était relativement restreint depuis que les chefs de l’État en France n’étaient plus cousins avec des têtes couronnées européennes (encore que l’affaire Khadafi, si elle avait été mise à jour pendant la présidence Sarkozy aurait pu constituer ce cas de destitution).
Le manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat est une notion beaucoup plus large que la haute trahison et aussi beaucoup plus floue. En droit pénal, une telle infraction violerait le principe de légalité des délits et des peines, car elle ouvrirait un large pouvoir d’appréciation arbitraire au juge pour dire ce qui est un manquement au devoir manifestement incompatible. Nous ne sommes toutefois pas en droit pénal, mais en « droit politique » en ce qui concerne le Président en exercice. Il n’y a évidemment aucune jurisprudence sur ce point et les parlementaires de 2007 avaient tous souligné le risque d’instrumentalisation politique de cette procédure dans les discussions en séance.
Évidemment, la destitution du Président de la République ne peut être prononcée que par le Parlement constitué en Haute Cour aux deux tiers de ses membres. Il faut donc un large consensus transpartisan pour destituer le Président de la République, sans doute poussé par une pression médiatique accrue.
Les troupes marchiennes ne s’étant pas débandées à l’assemblée nationale, ralliant le blanc panache du Président de la République malgré la gravité des faits, il était donc certain qu’une telle procédure de destitution, tout comme la motion de censure du 31 juillet n’aurait pas touché au but.
Néanmoins, les députés des oppositions expliquaient que cette motion de censure était importante pour que le Gouvernement vienne s’expliquer devant la représentation nationale. Le gouvernement a donc du en effet venir s’expliquer d’une dérive pour laquelle il n’est aucunement responsable. Hormis le ministre d’État Collomb qui a commis le pire crime qu’un ministre de l’intérieur puisse commettre, celui de n’être au courant de rien, ni le Premier Ministre Philippe, ni la Garde des sceaux Belloubet n’étaient directement ou indirectement impliqués dans les faits.
Pourquoi alors les députés se sentent-ils obligés d’en passer encore et toujours par le filtre du Premier Ministre dont le statut est, de président en président, sans cesse amoindri, et ce malgré les qualités de l’actuel preneur du bail à Matignon ?
Car il faut lire la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution :
« La décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l’article 68 de la Constitution.
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée. »
La proposition de destitution du président de la République doit donc être portée par le même nombre de parlementaires que pour une motion de censure. Pourquoi en ce cas n’avoir pas fait ce choix puisqu’il était clair que les turpitudes en cause ne concernaient que l’Élysée à l’exclusion du gouvernement ? Puisque la notion de manquement de l’article 68 de la Constitution est floue,pourquoi justement ne pas la préciser en créant une jurisprudence ? La violation délibérée de l’article 40 du Code de procédure pénale, le cautionnement du premier jalon d’une police parallèle constituent-il un tel manquement ?
Faut-il le rappeler encore, la limitation du droit à signer une proposition de destitution à une fois par mandat présidentiel a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2014-703 DC du 19 novembre 2014. Rien n’empêche donc d’attaquer tous azimuts (Alexandre Benalla, Alexis Kohler, les travaux somptuaires de la piscine etc…)
Une proposition de résolution détaillant les griefs contre le Président Macron aurait mis une pression considérable sur les députés de la majorité et sur le Président lui-même. Essuyer les plâtres d’une procédure jamais utilisée, même avec une majorité dévouée, est toujours ce que Bismarck appelait un « impondérable ».
« Quand les blés sont sous la grêle, Fou qui fait le délicat ! ». Délicatesse en effet de tirer à blanc sur le Premier Ministre quand vous avez toutes les possibilités juridiques de viser le vrai responsable.
A lire aussi sur Mediapart.
.
31 janvier 2017
De l’utilité des nullités de procédure pénale à soulever in limine litis
La nullité&
La nullité en procédure pénale est parfois vu par le tout venant comme le Graal du délinquant archi coupable qui peut s’en sortir grâce à un vice de forme.
Cette vision est erronée pour deux raisons. D’une part, même si certaines nullités de procédure sont parfois légitimes, leur reconnaissance par les juges est rarissime. Les nullités n’ont rien d’automatique et sont soumises à l’interprétation du juge qui place lui même le curseur déterminant si la loi n’a pas été appliquée ou si elle l’a été. Et les magistrats sont 90% du temps d’une sévérité telle que bon nombre d’avocats ont tout simplement abandonné l’idée de déposer des conclusions de nullité avant l’examen du fond de l’affaire de peur de mettre de mauvaise humeur le juge qui pourrait ensuite avoir la main plus lourde sur leur client.
Cette vision aussi me paraît erronée -et c’est la seconde raison- ; elle dépeint le magistrat comme une personne partiale, influençable, faisant peu cas de la procédure, et prompte à juger en fonction de la bonne ou mauvaise digestion de son déjeuner, finalement peu soucieuse de la bonne administration de la justice.
Car c’est bien de la justice dont doit se soucier l’avocat qui se demande s’il doit déposer des conclusions de nullité qui si elles sont retenues amèneront peut être la relaxe du client sans examen du fond.
Il n’est pas rare de voir les parquetiers faire appel de décisions de justice « dans l’intérêt de la loi ». C’est bien le même raisonnement qui doit conduire les avocats à systématiquement déposer des conclusions de nullité quand ils estiment que la procédure pénale n’a pas été respectée, même si ils craignent que le juge pourrait se venger sur leur client.
Dans l’inventaire des nullités, la plus efficace est sans conteste la nullité d’interpellation car cette dernière est le support nécessaire à tous les actes qui suivent et fait donc tomber l’ensemble de la procédure si elle est retenue. Rappelons au surplus qu’une interpellation violant la procédure fait nécessairement grief à celui qui l’invoque et qu’il n’est donc pas besoin d’invoquer un grief pour que la nullité soit retenue.
Cette nullité consiste le plus souvent à arguer que les forces de l’ordre n’avaient aucune raison plausible de soupçonner que la personne dont elles ont contrôlé l’identité a commis une infraction au sens de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
En effet, hors les contrôles effectués sur ordre du Procureur pendant une plage horaire donnée, sur un lieu donné, contrôles qui sont de véritables lettres de cachet généralisées, les forces de l’ordre ne peuvent pas contrôler l’identité d’une personne si elles ne dégagent aucun élément tangible permettant de penser qu’elle a commis une infraction.
Par exemple, la jurisprudence ne considère pas qu’une personne qui change brusquement de direction dans un lieu fréquenté avec des policiers qui arrivent dans sa direction soit un élément suffisant pour penser qu’elle a commis une infraction.
Malgré cela, il n’est pas rare de voir arriver en comparution immédiate des personnes interpellées parce qu’elle ont été vues en train de discuter sans échanger quoi que ce soit et que les policiers se soient contentés de cette discussion pour soupçonner un trafic de stupéfiants et effectuer un contrôle.
En ce cas, et quelle que soit la sévérité du juge, des conclusions de nullité doivent être remises au greffier avant tout débat au fond, même si les juges les rejettent sèchement, et même si dans le cas contraire, cela conduit à obtenir la libération d’un coupable.
Car si au mépris de la procédure pénale, votée par la représentation nationale, la justice condamne un coupable, elle le fait au prix de devenir elle-même coupable. Il n ‘y a pas de mal nécessaire; comme l’écrivait Nietzsche dans Par delà bien et mal : « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui même. Et quand le regard pénètre longtemps au fond de l’abîme, l’abîme lui aussi pénètre en lui ».
.
9 novembre 2016
Pour l’abolition de la comparution immédiate
.
Cette semaine, un collectif d’avocat a signé une tribune publiée dans Le Monde pour abolir la procédure de comparution immédiate.
Cette procédure permet au procureur de la République de poursuivre le prévenu devant le Tribunal correctionnel immédiatement après la fin de la détention provisoire faisant suite à un délit poursuivi par une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, ou de six mois en cas de délit ayant été investigué par une enquête de flagrance.
Elle permettait en théorie de désengorger les tribunaux pour juger des affaires simples, dont les faits ne posaient aucun problème d’interprétation, avec une audience courte.
Aujourd’hui, cette procédure est complètement dévoyée. Elle est devenue le fer de lance d’une magistrature pour qui la peine d’emprisonnement est devenue l’alpha et l’oméga de la justice pénale.
Soyons clair : Quand le procureur propose une comparution immédiate, il sait qu’il veut demander de la prison ferme pour le prévenu. Celui-ci, souvent mis sous pression pour en finir au plus vite, accepte. En 20-30 minutes d’entretien, il est bien souvent difficile à l’avocat de le convaincre qu’il peut solliciter un renvoi, pour que la procédure et les faits soient mieux inspectés par la défense. Il y aurait pourtant toujours possibilité de demander un contrôle judiciaire ou un bracelet électronique pour lui éviter la détention provisoire. Et quand bien même en cas de refus, cette durée de détention provisoire serait alors imputé sur la peine prononcée in fine. Le prévenu n’a aucun intérêt à participer volontairement à la parodie de justice qu’il s’apprête à vivre. Et pourtant, il accepte, peut être au fond, parce qu’il a naïvement confiance dans les juges qui vont se pencher sur son cas et qu’il espère une peine moins lourde s’il coopère et n’embête pas les magistrats avec un examen plus approfondi de son affaire.
Pendant l’audience, la plupart des prévenus sont interrogés sèchement par des juges qui magnifient le concept de justice inquisitoire. Ils ont déjà leur idée du dossier et leurs questions ne sont orientées que pour confirmer cette idée : l’audience est une corvée. La parole des policiers est prise pour argent comptant, celle des prévenus ignorée et souvent brocardée.
Et puis il y a les question sur la personnalité du prévenu. Alibi que se donnent les juges pour se donner l’impression de donner une dignité à l’individu qui passe sous les fourches caudines. En réalité occasion de mieux les enfoncer. La personnalité du prévenu, c’est le rappel du casier, c’est l’alcoolisme et/ou la toxicomanie, ce sont les réflexions morales, c’est enfin « travail, famille, patrie », les fameuses garanties de représentation.
Soyons clairs encore une fois, au risque de soulever un problème tabou en France. Les noirs, les arabes, les roms, sont surreprésentés parmi les prévenus. On peut avoir l’illusion qu’ils sont devant les juges parce qu’ils ont commis une infraction et pas parce qu’ils sont noirs, arabes, roms. La réalité est que ce sont ces populations sur lesquelles les yeux et les armes des forces de l’ordre sont braqués. La réalité est que les infractions qu’ils commettent sont celles déterminées par leur position sociale dont est en grande partie responsable l’État qui administre le pays.
Et s’ils vont en prison, ce n’est pas seulement du fait de leurs agissements, mais parce que bien souvent ils commettent, en plus de leur infraction, l’erreur fatale de n’avoir ni domicile, ni argent, ni famille stable, sésames indispensables dans un pays bourgeois qui voit ces critères comme la marque d’une dignité dont il faut tenir compte.
Bien souvent, le rescapé de la prison ferme en comparution immédiate est blanc, possédant, éduqué, et a une adresse fixe, dans les cas rares où l’on fait l’honneur de cette procédure à ce type de profils.
C’est une vérité floue, insaisissable donc inallégable (et accessoirement faisant l’objet de sanctions quand on ose l’invoquer), car le pouvoir a toujours refusé les statistiques ethniques. Le dernier arrêt de la Cour de cassation en matière de contrôle au faciès amorce peut être une maigre lueur d’espoir(avant dernier attendu). Aux États-Unis, l’on a aucun problème à évoquer la surreprésentation des noirs en prison, et le fait qu’ils sont bien plus contrôlés par les forces de police que les blancs. En France, prononcez le seul mot blanc à l’audience, et c’est la levée de bouclier :
La question raciale n’existe plus en France, et surtout pas quand elle concerne l’État, sa police et sa justice. Une chape de plomb s’est abattu sur ce sujet après ce que certains ont appelé l’overdose d’antiracisme des années 80. Les policiers, les procureurs, les juges de la comparution immédiate sont imperméables aux déterminismes étatiques fondés sur la race et la classe. Pas besoin de statistiques. On préfère croire à un mensonge palpable plutôt qu’à une vérité insaisissable. Passez votre chemin.
Il n’est pas question de ne plus penser la justice que par le prisme racial, de rêver d’un retour aux tribunaux coloniaux ou chaque ethnie avait ses propres juges, et d’exonérer les individus de leur responsabilité. Mais la comparution immédiate est devenue le symbole d’une justice de classe, dernier rouage d’une État bourgeois et blanc qui continue d’enfermer à la chaîne et à la minute les sans grade racisés de la République dans des prisons surpeuplées, insalubres, et infestées par les rats.
On m’objectera que tout cela est bien politique et peu juridique, alors concluons :
Le simple fait qu’en récidive, certaines audiences de comparution immédiate peuvent amener les juges a prononcer des peines de vingt ans de prison devrait nous amener à nous poser cette question: Est-il normal, même quand les faits sont présumés simples, que l’on puisse décider d’envoyer une personne en prison après une audience qui ne dure parfois pas plus de trente minutes? Est-ce la l’idée que l’on se fait du procès équitable?
20 septembre 2016
Quand la littérature adoucit la peine
.
La défense des prévenus et accusés a trop souvent tendance à s’arrêter au prononcé de la condamnation. Mais les avocats sont de plus en plus nombreux à intervenir devant le juge d’application des peines, en partenariat avec le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) pour élaborer des demandes d’aménagement et de réduction de peine en aidant les détenus à se réinsérer.
L’association Lire pour s’en sortir, créée par un avocat s’est donnée pour but d’accompagner les détenus qui le souhaitent dans la lecture de livres et la rédaction de fiches de lecture qui seront ensuite transmises au SPIP.
Si la lecture de livres ne permet certes pas d’obtenir une réduction automatique de peine, le sérieux avec lequel est suivi l’activité encourage le juge d’application dans ce sens, comme en dispose l’article 721-1 du Code de procédure pénale : « Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture […] »
Trop souvent, l’avocat dans sa plaidoirie se contente de demander un TIG (travaux d’intérêt général), ou un contrôle judiciaire sans aller au delà et proposer une alternative crédible qui permette au juge de ne pas envisager simplement une incarcération.
Autant que la procédure pénale, l’avocat pénaliste doit aujourd’hui connaître le travail de ces diverses associations qui imaginent quels peuvent être les meilleures peines, ainsi que les programmes de réinsertion adaptés pour chaque condamné.
.
24 août 2016
Quand les droits de l’Homme deviennent un outil au service du plus fort
.
Si certains les jugent futiles et devant passer au second plan, les polémiques sur la tenue vestimentaire des femmes musulmanes pratiquantes sont au contraire symptomatiques des problèmes que peuvent poser un système juridique qui repose sur des droits supposés universels et intangibles.
Parce qu’ils donnent l’illusion d’une protection la plus étendue possible, universelle et irréfutable en tout temps et partout, les droits de l’Homme sont en réalité des concepts flous, malléables et in fine le plus souvent mis au service des desseins des plus forts.
C’est ainsi que sont souvent invoqués à la rescousse des opinions du pouvoir, au delà des très prisées « valeurs de la République », les concepts juridiques opérants d‘ « ordre public », mais surtout pour ce qui nous intéresse cet été, de « dignité » et de » laïcité ».
Ainsi, si les femmes musulmanes françaises qui se voilent à la plage sont accusées par certains (et certaines) de violer la dignité de la femme en insultant le combat des femmes françaises qui se sont battues pour raccourcir leur tenue vestimentaire contre les diktats de leur époque, au contraire, en Arabie Saoudite ce sont les femmes qui ne se voilent pas à qui l’on reproche de violer la dignité de la femme. Où l’on constate que la France et l’Arabie saoudite sont deux pays qui ont un point commun: ils entendent réguler la tenue vestimentaire des femmes. Où l’on constate finalement que des concepts tels que la dignité, s’ils apparaissent généreux au premier abord, sont des armes très efficaces dans les mains des puissants car ils permettent à ces derniers de justifier leur volonté totalement arbitrairement, par l’invocation de valeurs ou de concepts à géométrie variable selon leurs besoin, et qui confinent à un dogme quasi religieux interprétable par eux seuls.
La laïcité française est aussi à cet effet, un exemple frappant. La loi de 1905 qui a été votée ne porte en aucune façon précisément les germes de la laïcité française des années 2000-2010 en voie de soviétisation. Cette loi est pourtant déclamée comme une valeur intangible de la République qu’il ne convient pas de réfuter, même par simple opinion, le plus pratique étant que personne ne la lit, et que tout le monde lui fait dire ce qu’il veut.
Pourtant si cela était le cas, que n’avons nous pas aboli le régime concordataire Alsace-mosellan? Y-a-t-il des valeurs de la République fondamentales qui ne le soient pas assez pour ne pas les appliquer sur l’entièreté du territoire métropolitain?
Devant cette incertitude, il serait tentant de se reposer sur l’idée selon laquelle il convient de respecter la volonté de chacun et de chacune à tout prix, ce beau mot de liberté, comme le pensent les anglo-saxons, du moment que cette liberté n’est pas menacée par l’aliénation de l’individu.
On reproche ainsi aux femmes musulmanes de subir des pressions pour se voiler, soit violentes, soit indirectes, par le biais du quand dira-t-on familial et culturel, et donc de ne pas être totalement libres. Mais les femmes s’habillant à l’occidentale sont elles aussi sujettes à l’aliénation, par des forces parfois au moins aussi fortes : regard des hommes, marketing, magazine de mode et de bien être. Les femmes occidentalisées heureuses doivent être maigres, consommatrices, disponibles sexuellement et professionnellement. Les pressions qu’elles subissent ne sont pas moins grandes que les femmes musulmanes françaises et pourtant on estime qu’elles peuvent choisir librement.
Souvent les puissants utilisent le concept de liberté pour en réalité oppresser la partie faible : employeurs, et capitaines d’industrie sont les premiers à invoquer la liberté du commerce et de l’industrie pour justifier des licenciements abusifs. La liberté, droit fondamentale, aussi beau concept soit-elle, est donc aussi une arme dans les mains des puissants pour oppresser les faibles. Et quand ces derniers s’en réclameront, on aura tôt fait d’invoquer juridiquement, la dignité, l’ordre public, ou même la « sécurité, première des libertés » pour contrecarrer leur velléités. On aura tôt fait de déclarer leurs opinions (revendications de droits pour les musulmans) contraires aux valeurs de la République. je ne sache pourtant pas que l’on pourchasse les royalistes qui expriment leurs opinions.
Il est donc nécessaire, pour savoir quel comportement adopter, quels choix politiques faire, de réfléchir selon un mode de pensée qui confine à l’ancienne chevalerie : Qui est le plus faible? Quelle partie est la moins bien dotée pour pour faire valoir ses droits, son point de vue?
En réfléchissant ainsi, on ne pourra manquer de déterminer que les femmes musulmanes qui choisissent, sans la contrainte directe de leur conjoint, de porter un voile à la plage sont celles qui doivent être défendues à tout prix en France et en 2016; Il convient pour nous, avocats, de se battre pour elles devant les tribunaux, et comme on le disait le 13 mai 1940 à Londres, il convient aussi que nous combattions sur les plages; car ces femmes subissent une pression accrue de la part d’une France aux nerfs à vifs; une France qui n’a pas pu s’empêcher de considérer le dogme musulman comme au moins en partie responsable des attentats qui l’ont frappé.
« Woman, thy name is failtry » écrivait Shakespeare il y a bien longtemps. Aujourd’hui, cette femme sur la plage niçoise à qui l’on demande de se découvrir, ressemblait furieusement au Capitaine Dreyfus à qui l’on brise son sabre dans la Cour des Invalides le 5 janvier 1895.
.
17 juin 2016
Droits des manifestants : la possession d’un tract édité par le syndicat des avocats utilisé comme élément à charge pour établir la culpabilité
.
Le parquet de Paris a franchi dernièrement un seuil dans le non sens et l’argumentaire mortifère mobilisé contre les opposants politiques en France.
En effet, lors d’une réquisition pour demander le placement en détention provisoire d’un mis en examen suspecté de violences lors d’une manifestation contre la loi travail, le procureur a cru bon et utile d’écrire :
« Enfin la découverte en perquisition chez X d’un document d’un syndicat d’avocats intitulé: manifestants-e-s: droits et conseils en cas d’interpellation vient corroborer la volonté manifeste de participer à des actions violentes en cours de manifestation puisqu’il prend des éléments sur la conduite à tenir en cas d’interpellation »
Certes, l’argument n’est utilisé qu’en dernier recours, certes d’autres éléments ont sans doute été pris en compte pour caractériser le comportement de ce mis en examen. Il n’empêche, le seul fait de raisonner ainsi vient dire aux manifestants et opposants que s’informer sur ses droits en cas d’arrestation arbitraire -et nous savons, que dans la confusion, voire en fonction de l’agenda politique, elle sont nombreuses- fait naître une suspicion, voire une conviction de participation a des actions violentes.
L’argument n’a, espérons le, pas emporté la conviction des juges indépendants du pouvoir exécutif, mais ce dangereux glissement amène sans doute à élargir la contestation du pouvoir en place. Plus encore que la défense des droits des salariés, le mouvement social actuel doit aussi se battre, dans cette urgence qui n’en finit pas, contre le recul des libertés fondamentales, contre de futures lois des suspects qui ne sont plus aujourd’hui simplement les fichés S pour djihadisme, mais toutes les personnes qui souhaitent se prémunir des abus de la puissance publique.
.
.
21 mai 2016
Adoption par la Commission paritaire de la loi pénale renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme
.
Alors que l’assemblée nationale à voté hier dans l’indifférence générale la prorogation de l’État d’urgence confirmant les craintes de tous les observateurs sur l’instauration d’une urgence permanente, et donc d’un recul durable des libertés publiques en France, l’adoption le 11 mai dernier par la Commission mixte paritaire d’un texte luttant contre le crime organisée et le terrorisme confirme une défaite tous azimuts des droits fondamentaux en matière pénale.
La Commission a en effet donné raison pour l’essentiel au Sénat contre la quasi totalité des propositions de l’Assemblée nationale qui maintenait un niveau de garantie plus élevé (mais pas acceptable pour autant) pour les droits de la défense, la séparation des pouvoirs, le contradictoire et le droit à la vie privée.
Ainsi, l’accès au dossier de l’enquête pour la personne visée par une enquête préliminaire ne pourra se faire qu’un an après le début de celle-ci contrairement aux six mois proposés par l’Assemblée nationale, retardant d’autant plus la possibilité d’exercer une défense effective et équitable.
De même les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction n’auront plus à être systématiquement motivées et le Sénat a eu gain de cause sur le transfert de la décision de mettre en place une écoute concernant un avocat au juge de la liberté et de la détention. Le juge d’instruction en reste ainsi responsable, le laissant seul décisionnaire, alors que l’intervention du juge des libertés et de la détention aurait pu conduire à un débat sur l’utilité et la légalité de la mesure.
Notons aussi, côté droit de la détention, que les services de renseignements pourront largement utiliser les « ISMI catchers » dans les établissements pénitentiaires qui permettent une écoute généralisée des conversations téléphoniques dans le périmètre où le système opère, promettant de graves entorses au droit à la vie privée des détenus.
Ces mêmes détenus pourront aussi beaucoup plus facilement faire l’objet de fouilles intégrales à nu si le chef d’établissement estime qu’il existe des raisons sérieuses de les diligenter. A l’heure ou des techniques modernes de détection existent, il faudrait pourtant clairement se poser la question du maintien de la pratique des fouilles à nu intégrales vis-à-vis de l’interdiction des traitements dégradants. Ce n’est pas le choix de la Commission mixte paritaire qui choisit de les faciliter.
.
.
3 mai 2016
Confirmation du coup porté au secret des conversations entre un avocat et son client
.
Après la décision dans l’affaire Paul Bismuth concernant les écoutes des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, la Cour de cassation vient de refuser de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la régularité d’écoutes téléphoniques entre un avocat et son client (Crim. 6 avr. 2016, FS-P+B, n° 15-86.043).
Rappelons que dans la décision Bismuth, la Cour de cassation avait circonscrit le droit à la confidentialité des écoutes entre l’avocat et son client au strict exercice des droits de la défense. Dans sa décision de refus de transmission, la Cour décide que les écoutes sont limitées par le respect des droits de la défense.
Or, la Cour de cassation a une vision très restreinte de ce qu’est l’exercice des droits de la défense. Seules sont concernées les personnes qui ont été à minima placées en garde à vue (et à fortiori mises en examen) pour la procédure en cours.
Et dans les faits, beaucoup de personnes ayant commis une infraction sont amenées à vouloir préparer leur défense avec leur avocat avant même qu’une procédure ne soit formellement ouverte contre eux. Las, la Cour de cassation considère qu’il ne s’agit pas là de l’exercice des droits de la défense, et les écoutes pourront donc être validées.
Ainsi, les avocats pénalistes sont aujourd’hui contraints de se passer de téléphone et de discuter de la défense avec leurs clients exclusivement dans leur cabinet, théoriquement sanctuarisé. Théoriquement. Car encore une fois dans les faits, les policiers n’hésitent pas à mettre en place des écoutes et sonorisations de domiciles ou de cabinets d’avocat grossièrement illégales pour « aller à la pêche », quitte à ne se servir des informations glanées que pour se mettre sur la piste de preuves qui seront alors recueillies légalement.
A cette allure là, les avocats en seront peut être bientôt à discuter avec leurs clients sur la proue d’un bateau-mouche au petit matin à la manière de Jean Gabin dans Le cave se rebiffe.
.
.
31 mars 2016
Perpétuité réelle incompressible : encore et toujours de la gesticulation politique
.
Le 30 mars, le Sénat est venu confirmer un amendement parlementaire voté par l’assemblée nationale dans le cadre de la réforme de la procédure pénale qui permettra aux Cours d’assises, dans le cas où elles prononcent une peine de réclusion criminelle à perpétuité en matière de terrorisme, d’assortir cette peine d’une impossibilité de l’aménager par une semi liberté ou une liberté conditionnelle.
La première des gesticulations politiques, c’est d’abord celle qui consiste pour les opposants de s’émouvoir de cette insertion de la perpétuité réelle dans notre arsenal de répression pénale.
En effet, cette possibilité est déjà ouverte aux Cours d’assises qui sanctionnent par la réclusion criminelle à perpétuité les assassinats commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, mineurs de moins de quinze ans et/ou commis accompagnés d’actes de barbarie, viols ou tortures.
La seconde gesticulation politique est hélas, celle du législateur. Eu égards à la Convention européenne des droits de l’Homme, il n’est pas possible en France d’instituer une perpétuité qui ne puisse pas donner lieu à la possibilité d’un aménagement au bout d’un certain nombre d’année d’incarcération.
C’est parce qu’il existe dans notre Code de procédure pénal un article 720-4 alinéa 3 qui précise que si la Cour d’assises a prononcé une impossibilité d’aménagement avec la perpétuité, il est néanmoins possible au bout de trente ans de solliciter de façon exceptionnelle un aménagement de peine auprès du Tribunal d’application des peines, que la Cour européenne des droits de l’Homme a validé le système que le législateur compte appliquer au terrorisme.
Sa jurisprudence a fait ressortir depuis longtemps un droit pour le condamné à demander un aménagement de sa peine, même s’il est incarcéré à perpétuité, car ne donner aucun espoir à une personne condamnée de recouvrer la liberté équivaut à un traitement inhumain et dégradant.
La possibilité de s’amender est considérée, sans doute du fait de l’influence chrétienne que connaît (ou subit) encore notre société, comme un élément fondamental de la nature humaine.
Cet article 720-4 alinéa 3 n’a pas été supprimé par l’assemblée, ni par le Sénat non par négligence mais par obligation. Pour citer Monsieur Michel Mercier :« Nous sommes, je crois, à la limite de ce que la Constitution et nos engagements internationaux nous autorisent à faire ».
En d’autres termes, en droit, la perpétuité réelle incompressible pour fait de terrorisme n’est rien d’autre qu’un ajout de 8 ans de plus à la période de sûreté maximale pour terrorisme.
Rappelons à toutes fins utiles que quel que soit le régime de période de sûreté, la possibilité de demander un aménagement de peine n’équivaut pas à une libération conditionnelle automatique pour le condamné. Ainsi, la possibilité en France pour un condamné à perpétuité de passer le restant de sa vie en prison est bien réelle, réforme ou pas, en fonction de son comportement ou du zeit geist, la dernière décision de la Cour d’appel de Paris concernant Patrick Henry en atteste. Et ne parlons même pas de la rétention de sûreté à l’issue d’une longue peine hors perpétuité.
Enfin, il faudrait aussi s’interroger au delà du droit, sur l’opportunité et la justification de sanctionner aussi durement des criminels politiques qui utilisent une stratégie guerrière, certes abominable, mais qui ne constitue rien d’autre que l’arme du sans grade face au possédant. Nul doute que si les membres de l’État islamique disposaient d’avions Dassault Rafale ou Mirage 2000, ils tueraient des civils à 10000 mètres d’altitude aussi bien que ce que font nos forces armées à Racca sans se donner la peine de se faire exploser en même temps. Or personne n’estime utile de condamner nos pilotes de chasse à la réclusion criminelle à perpétuité, et encore moins à les empêcher de solliciter un aménagement de peine.
.
.
24 mars 2016
Affaire Abdeslam : retour sur la procédure du mandat d’arrêt européen
Salah Abdeslam, l’un des principaux suspects des attentats du 13 novembre à Paris, a été arrêté en Belgique alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises, mandat d’arrêt qui a été renouvelé à la suite de son arrestation.
Cette procédure du mandat d’arrêt européen a été instituée par la décision-cadre du 13 juin 2002 du Conseil européen. Elle ambitionnait une remise quasi-automatique de la personne arrêtée à l’État d’émission du mandat par l’autorité judiciaire de l’État requis qu’on appelle État d’exécution, en dehors de toute procédure d’extradition.
Dans les faits, l’autorité judiciaire de l’État d’exécution reste libre de refuser le transfèrement de la personne en fonction de critères limitatifs listés à l’article 4 de la décision-cadre.
L’avocat belge de Salah Abdeslam a évoqué une autre cause autonome de refus : le non-respect des droits fondamentaux par l’État d’émission. Cette cause de refus ne figure pas dans la décision-cadre mais elle a été implicitement reconnue par plusieurs juridictions suprêmes nationales et la Cour de justice de l’Union avec la réserve suivante :
Le mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres, lesquels sont présumés respecter les droits fondamentaux listés dans les différents traités européens. Ainsi une telle argumentation ne pourra être retenue par les juges nationaux pour faire droit à une demande de refus de transfert s’il s’agit de simples allégations. La jurisprudence des juridictions suprêmes nationales et de la Cour de justice de l’Union a tendance à faire primer l’efficacité du mandat d’arrêt européen sur le respect des droits fondamentaux par les États membres.
Le contexte français est toutefois bien particulier après les attentats de 2015. De nombreuses lois liberticides ont été adoptées ou sont en cours d’adoption et l’on peut légitimement se demander si la procédure pénale française applicable aux personnes suspectées de terrorisme ne contient pas de graves violations des droits fondamentaux, notamment vis à vis du procès équitable, violations propres à renverser la présomption de respect des droits fondamentaux par la France. En effet, qu’est-ce qui justifie au regard des garanties du droit européen qu’un terroriste, un criminel politique donc, soit moins bien traité qu’un assassin de droit commun au regard de la présence des possibilités d’action de l’avocat, de l’accès retardé au dossier de la procédure, et de l’impossibilité d’être jugé par un jury populaire ?
Salah Abdeslam et son avocat en sont conscients et c’est pourquoi ils comptaient s’opposer au transfert en France dont le contexte socio-politique et légal n’était pas favorable. C’était avant les attentats survenus en Belgique qui ont fait changer brusquement leur stratégie.
Le contexte belge, du fait de la plus grande fraicheur des évènements pourrait finalement s’avérer plus difficile encore pour la défense que le contexte français. C’est faire le pari que la Belgique et son peuple prendront le même tournant sécuritaire et liberticide que la nation française comme réponse au terrorisme, ce qui est loin d’être certain au regard de l’exemple espagnol à la suite des attentats de la gare d’Atocha de 2004 qui avaient conduit à l’éviction du gouvernement Aznar, lequel proposait le même tournant sécuritaire et liberticide que le gouvernement français actuel.
En tout état de cause, la loi belge applicable actuellement est beaucoup plus conforme aux droits fondamentaux que la législation française en fait de terrorisme. En matière de garde à vue par exemple, la loi belge prévoit une possibilité pour le suspect d’être gardé à vue après prolongation pour 48 heures maximum (avec obligation pour le juge de spécialement motiver la prolongation) contre 144 heures en France, avec de surcroit des fortes restrictions des droits de la défense pendant ce délai exorbitant du droit commun.
Paradoxalement, les attentats de Bruxelles pourraient finalement contrarier les nouveaux souhaits de Salah Abdeslam car les autorités judiciaires belges sont tentées de le suspecter pour ces évènements et le contexte politique tendu pourrait les influencer. Au sens de la décision-cadre, elles peuvent juridiquement décider de refuser son transfèrement si elles estiment que les infractions commises en France ont été commises « en tout ou en partie » sur leur territoire. Or il est probable que les attentats commis en France ont été préparés en Belgique, ce dont pourront tirer argument les autorités belges.
La haute confiance entre les États membres qui garantit la bonne exécution du mandat d’arrêt européen pourrait donc être mise à l’épreuve au regard des amabilités envoyées aux autorités belges par une partie de la classe politique française. Logiquement, si les États se font confiance pour appliquer le même degré de fermeté envers le terrorisme, quelle est l’opportunité que Salah Abdeslam soit jugé dans un pays plutôt que l’autre alors que ces deux territoires ont été également touchés par la même organisation dont ferait parti le suspect ?
.
.
17 mars 2016
Réforme de la prescription pénale : Le dernier texte avant l’imprescriptibilité?
.
L’assemblée nationale a voté le 10 mars dernier un allongement de la prescription des délits de trois ans à six ans et des crimes de dix à vingt ans. Elle a surtout techniquement voté la généralisation du report du départ du délai de prescription à la découverte des faits par les autorités.
En effet en son article 9 le proposition de loi votée précise :
» Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément
toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. «
Le rapporteur de la loi, Monsieur Alain Tourret, s’est réjoui au moment de l’adoption en commission, que « cette proposition de loi est sans doute le dernier texte que nous votons avant l’imprescriptibilité. »
A notre sens, ce texte entérine déjà techniquement l’imprescriptibilité dont les tenants de cette proposition nous assure qu’elle est la norme dans le monde anglo-saxon, faisant fi du droit des justiciables à être jugés dans un délai raisonnable en conformité avec le droit européen.
MM. Tourret et Fenech expliquent que les progrès scientifiques, la détection des traces ADN, l’allongement de la durée de la vie, rendent nécessaire cette réforme. Mais malgré tout les progrès scientifiques, la mémoire humaine, elle, reste faillible. Quelle sera l’utilité pour la société, les plaignants et les suspets d’enquêter, d’instruire, de juger des infractions comme un viol avec des témoignages vieux de vingt ans, voire plus, en fonction du départ du délai de prescription?
« Nous vivons désormais, à l’heure d’internet, dans une société de la mémoire et non plus de l’oubli » dit enfin Monsieur Fenech pour justifier cette réforme.
La prégnance des réseaux sociaux et leur dangereuse capacité d’absorption des informations qu’ils gardent le temps passant, ont pourtant amené la société a instaurer un droit à l’oubli dont cette réforme semble oublier la pertinence.
.
.
26 février 2016
Inégalités diverses pour les minorités en prison
.
Le récent arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016 n° 385929 et le dernier avis d’Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont l’occasion de constater qu’il ne fait pas bon être une minorité en prison.
Adeline Hazan a en effet pointé dans son avis le fait que les femmes, puisque moins nombreuses que les hommes, et à cause de la prohibition de la mixité, sont victimes de discriminations. L’accès aux locaux communs (bibliothèque, salle de sport etc…) leur est souvent difficile de même qu’elle sont souvent obligées de se contenter de participer à des activités de loisir genrées (couture, broderie), les autres étant monopolisées par les hommes.
Le peu de prisons pour femmes les oblige aussi bien plus que les hommes à être emprisonnées loin de leurs proches, mettant ainsi en péril leur droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, les mineures sont bien souvent obligées d’être internées avec leurs aînées, le nombre de centres de détention pour mineurs étant faible et là encore, occupés en nombre par les garçons.
L’arrêt du Conseil d’État précité n’est pas plus clément avec les détenus de confession musulmane. Il vient confirmer un arrêt d’appel qui n’avait pas estimé que le fait que le directeur de la prison refuse de faire servir des repas halal régulièrement en prison soit contraire à la liberté de religion portée notamment par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’un système de cantine permettait aux détenus de se procurer des menus complémentaires conformes à leurs obligations religieuses sur leurs deniers et qu’une aide financière existait pour améliorer les conditions d’existence des détenus les moins fortunés, laquelle pouvait le cas échéant servir à payer cette nourriture.
Les juges du palais Royal ont donc décidé de faire peser le coût de la liberté religieuse en prison sur les détenus plutôt que sur l’État.
Ainsi, alors que les détenus non musulmans peuvent destiner leurs entiers subsides à leurs loisirs ou leur développement personnel, les musulmans eux, sont obligés d’en consacrer une partie à une nourriture conforme à l’exercice de leur liberté religieuse.
.
.
18 février 2016
État d’urgence : retour sur trois mois de gesticulation juridique
.
«Le droit est fait pour les Hommes et non l’inverse». Cette maxime bien connue des juristes nous explique que le droit n’est pas une œuvre abstraite qui régit éternellement et uniformément la vie des citoyens selon des principes irréfragables mais une matière évolutive qui doit s’adapter aux besoins sociaux économiques d’un peuple en fonction des circonstances temporelles et spatiales.
Pour autant les évènements de novembre dernier, comme d’autres avant eux, semblent avoir encouragé le gouvernement a utiliser le droit non pas comme un outil permettant d’encadrer son action pour faire face, mais comme un expédient servant à justifier aux yeux des français son activité et à prouver sa diligence, l’opinion publique était très largement en faveur d’ un renforcement de la politique sécuritaire sans que l’équilibre de nos institutions ou les droits individuels ne constituent une préoccupation majeure.
Cette attitude a accouché de plusieurs non-sens juridiques au premier rang duquel, l’utilisation de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l »Homme pour suspendre une partie de son application en France, le projet de modification de la Constitution pour y intégrer la déchéance de nationalité des personnes condamnées pour terrorisme et enfin, le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale.
Peu après les attaques terroristes du 23 novembre, l’état d’urgence fut déclaré par le Président de la République et très vite, le premier réflexe du gouvernement fut de signifier à la Cour européenne des droits de l’Homme son intention de faire usage de l’article 15 de la Convention permettant de suspendre la garantie d’un certain nombre de droits prévus par elle en cas de guerre ou de péril menaçant la vie de la Nation.
D’un point de vue tactique, cette initiative fut fort opportune pour le gouvernement car la jurisprudence de la Cour montre qu’elle a tendance à condamner certaines atteintes aux droits de l’Homme quand rien ne lui a été notifié et à faire l’inverse quand notification il y a eu, à atteinte équivalente.
Symboliquement au contraire -et ce gouvernement semble être attaché aux symboles-, l’image donné d’un pays attaqué par des individus dont on ne cesse de nous répéter qu’ils abhorrent les droits de l’Homme mais qui s’empresse de les suspendre ne manqua pas de faire transparaitre quelque contradiction philosophique.
Plus encore juridiquement, si la notion de péril menaçant la Nation cadre avec les récentes attaques terroristes, il est improbable que l’État français puisse suspendre l’application de la Convention «jusqu’ à ce que Daech soit éradiqué» pendant une guerre qui pourrait concerner «une génération», selon les mots du Premier Ministre, alors même que cette suspension ne peut être que temporaire et que le péril menaçant la Nation doit être sans cesse réévalué. Sachant que la France est touchée par des attentats islamiques depuis plus de 30 ans, cela aboutirait potentiellement à une suspension permanente de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Le projet de révision de la Constitution aux fins d’y intégrer la déchéance de nationalité semble s’être embourbé sur des chemins encore bien plus boueux.
D’ une part le Code civil permet déjà de déchoir de sa nationalité n’importe quel Français et a discrétion du gouvernement si celui estime qu’un individu prête son concours a une force armée étrangère, et ceci, sans l’intervention d’un juge à priori.
Las, Le gouvernement prévoit d’inscrire cette possibilité dans la Constitution pour des raisons symboliques, et veut faire intervenir le juge judiciaire dans cette décision, alors que le Code civil lui permettant de s’en passer. Étonnant choix quand a pu constater la défiance dont a fait preuve le gouvernement envers le juge judiciaire pendant la mise en place de l’état d’urgence et dans ses projets de loi.
Cela sans compter que l’article 34 de la Constitution dévolue normalement la matière de la nationalité à la loi. En effet, la Constitution est un texte qui a vocation à régir l’équilibre de nos institutions politiques et non à rentrer dans le détail dévolu au pouvoir législatif et administratif.
Enfin, Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale constitue le climax de la croyance du gouvernement que le pouvoir judiciaire est synonyme d’inefficacité de la politique pénale. Alors que le bon sens amènerait à constater que les moyens dévolus aux juges judiciaires sont beaucoup trop bas, tant en terme d’effectifs que de financement en général, le gouvernement préfère adopter une politique d’effacement généralisée du pouvoir judiciaire dans la lutte contre les infractions pénales au mépris de la séparation des pouvoirs.
L’application de l’état d’urgence a déjà permis de constater la méfiance du gouvernement envers les juges. Ainsi, au lieu de soumettre l’action de son administration au contrôle du juge judiciaire, il a préféré faire appel au pouvoir législatif pour mettre en place un observatoire de l’état d’urgence, totalement inopportun non seulement car ce n’est pas le rôle de l’assemblée de contrôler l’exécution des lois, mais aussi et surtout parce que la pratique de la Vème République a fait émerger un Parlement totalement inféodé au pouvoir exécutif. Il n’est pas inutile de se souvenir qu’une des occasions les plus marquantes au cours de laquelle le pouvoir législatif supplanta le pouvoir judiciaire dans ses attributions, fut celle du procès de Louis XVI jugé par la convention nationale dans des conditions dont on ne peut pas dire là aussi qu’elles aient caractérisées l’orthodoxie juridique la plus pure. Vu le contexte institutionnel français, cette attitude aboutit à une concentration du pouvoir de plus en plus généralisée dans les mains du pouvoir exécutif.
Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale prend définitivement le chemin de la réduction du pouvoir judiciaire. Il confirme un grand mouvement d’administrativation de la répression pénale soi-disant pour désengorger les tribunaux judiciaires, mais qui provoque en réalité un renforcement sans précédent du pouvoir exécutif dont le seul contrepouvoir devient le juge administratif, qui s’il appréhende de mieux en mieux son nouveau rôle de gardien des libertés est toujours structurellement très sensible à la cause du pouvoir exécutif.
La procédure pénale nouvelle permettra ainsi un renforcement considérable du rôle du préfet et du procureur-soumis au pouvoir exécutif- en matière de contrôles d’identité et d’assignations à résidence, au détriment du juge d’instruction. Si la plupart des avocats pénalistes ne pleureront pas sur l’emmurement à vif progressif du juge d’instruction, magistrat doté de pouvoir d’enquête et de jugement ne lui permettant pas psychologiquement de garder une impartialité objective, ils ne pourront que regretter que les autorités de poursuites se voient considérablement renforcées, alors que d’une part, elles ne sont pas indépendantes du pouvoir exécutif, et que d’autre part, les droits dévolus à la défense évoluent beaucoup plus lentement, voire parfois, reculent.
Ajoutons que les circonstances de l’adoption de cette loi ne vont pas là encore sans une contradiction sémantique importante témoignant que le recul des libertés fondamentales est très loin d’être conjoncturel. Ainsi l’exposé des motifs du projet de loi nous explique que celui-ci est porté par « la conviction du gouvernement de la nécessité d’une adaptation de notre dispositif législatif de lutte contre le crime organisé et, plus particulièrement, le terrorisme afin de renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence ». Autrement dit, le gouvernement nous explique d’une part que les mesures de l’état d’urgence sont justifiées par le caractère exceptionnel des circonstances, et que ces mêmes mesures auront pourtant vocation à perdurer dans la durée grâce à la loi. En matière pénale, l’urgence sera donc permanente.donc permanente.
.
.
13 décembre 2015
.
Etat d’urgence. Perquisitions, gardes à vue, assignation à résidence. Selon quels critères? Débat vidéo à la rédaction de Mediapart
.
.
29 novembre 2015
.
La République placée en garde à vue,Tribune sur Mediapart
.
.